Pendant longtemps, et peut-être depuis le début, même les partisans de la décroissance ne sont pas allés jusqu’au bout de ce que « décroissance » peut politiquement dire.
Trois livres récents sont pourtant venus (me) confirmer les distinctions que je défendais depuis mon Politique(s) de la décroissance (Utopia, 2013) : a) ne pas confondre entre objection de croissance (qui se contente souvent de prôner l’arrêt de la croissance) et décroissance (qui affronte la question de la « décrue » pour repasser sous les plafonds de l’insoutenabilité écologique) ; b) être capable de distinguer trois angles pour défendre la décroissance 1 – le rejet, le trajet et le projet – permet de définir la décroissance d’abord comme l’époque du trajet.
Voici ces 3 livres :
- Reprendre la terre aux machines, de l’Atelier paysan (Anthropocène Seuil, mai 2021)2.
- Héritage et fermeture,une écologie du démantèlement, d’Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre Monnin (Divergences, mai 2021)3.
- Ralentir ou périr, de Timothée Parrique (Seuil, septembre 2022)4.
Chacun de ces 3 livres apporte une pierre à la construction d’une maison commune de la décroissance :
- Dans son chapitre 4, celui de l’Atelier Paysan ose enfin s’attaquer aux racontars de « la transition qui a déjà commencé ». C’est une pierre dont nous avons besoin dès que l’on veut critiquer l’impasse politique qui menace le scénario de transition par essaimage (et ses diverses variantes).
- Par les notions de « communs négatifs » (chapitre 1) et d' »héritage » (chapitre 3), étaient enfin abordées les difficultés politiques : comment partir d’un monde à partir de ce même monde. C’est une pierre dont nous avons besoin dès que l’on veut critiquer toutes ces métaphysiques du saut qui – sous prétexte de radicalité mal fondée – en viennent à se raconter qu’une transition sera une sorte de rupture immédiate et sans frais pour repartir d’une page vierge de tout héritage.
- C’est dans ses chapitres 6 et 7 que Timothée Parrique construit explicitement la différence entre la décroissance (le trajet) et la post-croissance (le projet). C’est une pierre dont nous avons besoin quand on veut défendre une décroissance qui, même portée par un projet, ne constitue pourtant pas stricto sensu un projet (La décroissance et ses déclinaisons, Utopia, 2022, pages 89-91). De la même façon qu’un sevrage ne peut pas être un projet de vie, la décroissance ne peut pas être un projet de société : dans les deux cas du sevrage et de la décroissance, ce ne sont que les conditions d’un projet, pas le projet lui-même.
Ces 3 livres ont chacun une utilité différente, politique, conceptuelle ou médiatique, et le combat en faveur d’une décroissance politique est loin d’être gagné, loin, beaucoup plus loin que ne cessent pourtant de le raconter certains de ses partisans.
*
C’est donc avec attention que tout décroissant attend la suite de ces ouvrages.
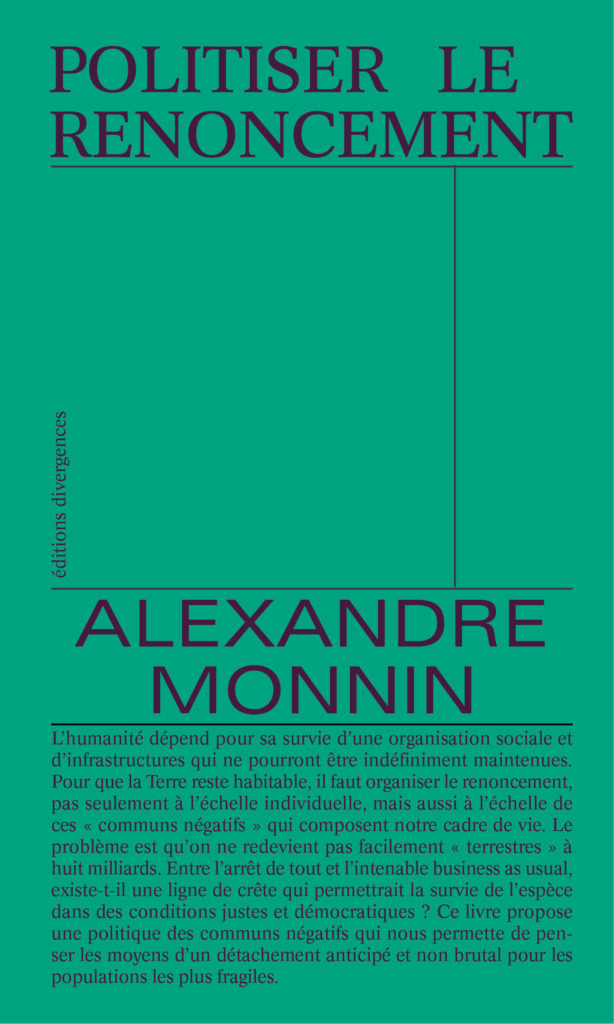
Alexandre Monnin vient de sortir aux mêmes éditions divergences (avril 2023), Politiser le renoncement : « Une certaine lecture d’Héritage et fermeture a pu laisser accroire que le livre s’intitulait Fermeture et fermeture. Il n’en est rien » (première page de l’Introduction).
A ce jour, on peut trouver de bonnes analyses sur le livre et des interviews éclairantes de l’auteur 5, et ce ne sera donc pas l’objet de ce compte-rendu.
Par rapport au livre précédent sur l’écologie du démantèlement, quels sont les apports qui pourraient se révéler féconds d’un point de vue décroissant, et plus exactement du point de vue de la décroissance telle que la MCD la construit, la discute et la défend ? « Notre point de vue », notre biais, c’est la défense d’une décroissance politique dont le pivot est bien cette « époque » (ἐποχή / epokhế) qui s’intercale – historiquement et conceptuellement – entre le rejet (objection de croissance) et le projet (post-croissance). Pourquoi cette attention à la décroissance politique ? Parce que nous faisons l’hypothèse que c’est bien cette décroissance politique qui seule constitue le noyau commun à tous les décroissants. Et inversement : quand nous lisons des décroissants se réjouir de la décroissance comme d’une « mosaïque » – dans l’illusion que la décroissance commune résiderait dans l’intersection de ses facettes alors que cela ne peut aboutir qu’au plus petit dénominateur commun – nous faisons le diagnostic qu’il n’y a là que dépolitisation (ou plus exactement, « Petite politique », ou impolitisation). Donc « politiser le renoncement », la fermeture, l’héritage… oui, c’est bien là la question !
*
Les 3 apports que je vais relever ont en commun de fournir des concepts et des arguments pour politiser la décroissance : pour rétorquer aux décroissants qui croient pouvoir esquiver la politisation au nom finalement d’une évidence de la décroissance. Eh bien non, la décroissance, ce ne sera pas forcément très facile ; mais pour s’y préparer politiquement, il ne faut la considérer ni comme nécessaire ni comme impossible.
- Le premier prétexte pour faciliter politiquement la décroissance, c’est de la déclarer « inévitable » ou « inéluctable ». Cette facilité n’est possible qu’à condition de réduire la croissance à la seule dimension « physicaliste » : par ce terme général, j’englobe toutes les variantes de la décroissance qui la réduisent à la démographie, à l’énergie ou aux matières, à l’économie (fut-elle bioéconomie). Ce réductionnisme consiste en fait à écarter ce que dans le livre de la MCD nous nommions « le monde de la croissance et son idéologie » et pour lequel je préfère maintenant reprendre l’expression d’Onofrio Romano : le « régime de croissance ». Comme je l’ai montré ailleurs, ce régime n’est pas seulement un « imaginaire » mais il est aussi une « forme » (celle de l’horizontalisme, de la neutralité institutionnelle…). Dans l’imaginaire de la croissance – dont il faut se coloniser, selon S. Latouche – on peut y repérer des modes de vie (Mark Hunyadi), des injonctions à la stabilisation dynamique (Harmut Rosa) mais aussi des « héritages ». C’est ce dernier point que travaille Alexandre Monnin quand dès le début du livre il se situe sur une « ligne de crête », entre les 2 précipices de la facilité, celui de la « rupture » et celui du business as usual. Dans ce dernier cas, on ne part pas du monde, on le continue. Dans celui de la rupture, on prétend bien quitter ce monde, mais d’un coup, d’un saut directement, sans intermédiaire. Pour le dire dans le vocabulaire de l’écologie du renoncement, dans le premier cas, on ne ferme pas et dans le second, on n’hérite pas. Ce qu’il faut assumer, c’est donc bien « héritage et fermeture », continuité et rupture, « partir à partir de ». C’est là que la notion de « commun négatif » intervient : non, tout commun n’est pas bucolique ; oui, il y a du négatif dont il va falloir hériter 6. Mais dans ce livre, Alexandre Monnin avance d’un cran en distinguant entre 2 types de « ruines ». D’abord les déchets en tous genres (organiques, nucléaires, les « rebuts de la Technosphère »…), les pollutions à grande échelle, les désastres écologiques… qu’il nomme des « ruines ruinées ». « Elles ne sont cependant pas les seules. Car le plus ruineux aujourd’hui, ce ne sont pas les mines à ciel ouvert, par exemple, mais les dispositifs qui commandent de les creuser… cette deuxième catégorie de ruines, je les nommes « ruines ruineuses ». C’est la ruine encore productive : productive de nouvelles ruines, à leur tour ruineuses et ruinées » (page 39). La « ruine ruineuse », c’est celle qui ne veut pas mourir, c’est celle dont il faut tenir compte pour briser les rêves iréniques de tous ceux qui confondent redirection et (pure) rupture. C’est celle qui, même dans une économie libérée de l’emprise de la croissance économique, continuerait à exercer son emprise. C’est celle qui indique qu’on ne pourrait rien imaginer de pire qu’un régime de croissance sans croissance (économique).
- Mais pourquoi ne suffit-il pas de prendre conscience de ces ruines ruineuses pour s’en détacher ? Parce que nous y sommes attachés. Voici ce que dit A. Monnin dans l’itw d’U&R : « Il ne suffit pas de déclarer qu’il faut se passer de voitures (électriques ou non – même s’il faut absolument se passer des SUV dans tous les cas !) : le problème, c’est qu’il faut aussi prendre en compte les attachements qui ont été tissés, la dépendance réelle d’une bonne partie des populations à ce mode de transport. Il serait sans doute préférable de passer par une soutenabilité faible – dont la voiture électrique est un élément – pour évoluer vers une soutenabilité forte, qui suppose une refonte des modèles d’urbanisme et des infrastructures de transport. S’il s’agit de décarboner le statu quo, cela n’a aucun sens ; mais si c’est une manière de se donner du temps pour opérer une véritable redirection écologique, là, c’est intéressant ». A. Monnin met ici parfaitement le doigt sur plusieurs défis politiques que doit affronter une décroissance démocratique : celui du temps, et donc celui du temps à accorder aux trajectoires : bien sûr il y a une urgence mais elle ne doit jamais justifier la moindre brutalité. Et pourquoi du temps ? b) Parce qu’il y a attachement à des dispositifs, à des choses 7, à des pratiques, à des commodités… Il me semble particulièrement intéressant que le thème de l’attachement (et sa suite : désattachement et réattachement) apparaisse dans les pages qui posent le défi politique de l’arbitrage. Qu’est-ce en effet qu’arbitrer ? C’est « juger » au sens fort de « trancher » ; et là nous sommes au cœur même de la politique, au sens où l’une des causes les plus fortes de la dépolitisation (ou de l’impolitisation) réside dans la « tyrannie de l’horizontalité », c’est-à-dire dans l’emprise exercée par la réduction du « juger » au seul « opiner ». C’est pourquoi il est particulièrement bienvenu de rappeler qu’un arbitrage peut être « démocratique » à condition d’être « anticipé » et surtout « non-brutal », c’est-à-dire s’il prend en compte les attachements dont il va falloir se libérer, ce qui nécessitera des « protocoles de renoncement » » (Diego Landivar). C’est cette attention dirigée contre les risques de brutalité qui permet de rediriger la question politique des cadres de la désirabilité et de la faisabilité vers les protocoles de l’acceptabilité politique.
- A ceux qui « sautent » l’étape de la redirection parce que pour eux c’est la rupture qui permet de passer – sans transition – du monde qu’ils rejettent à celui qu’ils désirent, comment ne pas leur reprocher une insensibilité politique, celle de (se) raconter que ce qui est désirable pour eux l’est aussi pour les autres ?
- Autrement dit, il ne suffit pas que les décroissants (se) racontent que leurs projets sont faisables (les alternatives concrètes comme « préfigurations ») et désirables (même si nous partageons les mêmes valeurs, nous ne sommes pas pour autant contraints de croire que la victoire de la décroissance sur le régime de croissance résultera d’un conflit des valeurs) ; en effet, faisable par nous et désirable pour nous ne veut pas dire acceptable pour les autres. A moins d’abandonner toute exigence démocratique, il est inacceptable de fonder une politique en (se) racontant que l’on fera faire aux autres même ce qu’ils ne trouvent pas désirable.
- C’est pourquoi la question politique de l’acceptabilité (individuelle et sociale) est fondamentale : même si – parce qu’il faut savoir distinguer entre « accepter » et « tolérer » – il vaudrait mieux exiger que nos propositions politiques soient tolérables (car on « tolère » même ce que l’on n’accepte pas, même ce avec quoi nous sommes en désaccord ; car si on ne tolère que ce que l’on trouve acceptable, on n’est pas tolérant, on est juste d’accord).
- Mais comment rendre acceptable/tolérable une redirection à ceux qui ne la jugent (opinent) pas désirable et qui auraient bien raison de la juger (estimer) intolérable si on la leur « faisait faire » 8 ? Bref, comment faire démocratiquement ? A chaque fois qu’Alexandre Monnin rencontre cette question (et c’est le cas tout au long d’un livre qui veut « politiser »), c’est la même piste qui est suggérée : celle de l’enquête (au sens de John Dewey). L’enquête, c’est le contraire de la révélation, révélation que je crois être au fond la méthode à laquelle tous les « décroissants du saut » (la rupture par un claquement de doigt ou par la prise instantanée de conscience) – ceux qui évitent ainsi toutes les questions des héritages, des attachements, des communs négatifs avec qui il faudra faire… – confient le miracle de rendre politiquement acceptable ce que eux jugent désirable et qu’ils sont déjà en train de faire. Cette révélation, c’est un phlogistón politique, c’est la démocratie court-circuitée. Comment alors réintroduire la lenteur des essais et des erreurs si caractéristique de la démocratie : par l’enquête comme « démarche expérimentale » (page 109) où rien ne garantit que le processus dialogique et délibératif soit suffisant pour dépasser les conflits (page 48). Mais alors pourquoi confier à l’enquête le soin du processus démocratique ? Parce que l’enquête est précisément la « méthode » qui permet non seulement de a) repérer les « problèmes », les « zones de friction » (page 120) mais aussi de b) les situer, les cartographier. Ce genre de considérations font résonance avec les thèses de la décroissance politique – défendues par la MCD, et exposées en ouverture du récent colloque de Polémos – selon lesquelles « c’est la mise sous le tapis de l’emprise du régime de croissance même à l’intérieur de nos alternatives qui, en écartant la vertu politique du conflit, en vient à favoriser une préférence pour des scénarios contradictoires de basculement dont l’irénisme (anthropologique) débouche sur le contresens (historique) de penser la décroissance plus comme un « saut » que comme un trajet ». Mise sous le tapis de la conflictualité qu’il est permis d’espérer contrer par, tout au contraire, la mise en évidence de ce que j’appelle une « cartographie systémique » dans laquelle, bien loin d’un simple inventaire systématique, chaque initiative – tant dans la recherche que dans l’activisme – sera située sur des trajectoires (des territoires, des temporalités, des institutions, des conduites).
*
3 apports à la construction du corpus de la décroissance politique, cela fait déjà beaucoup, même si d’autres lectures feraient certainement un autre relevé que le nôtre.
Je voudrais finir cette lecture effectuée sous le biais de la décroissance politique par deux interrogations :
- La première concerne le reproche adressé à l’ouvrage de ne pas être d’un accès facile. Ce n’est pas faux, parce qu’il est difficile de rentrer dans certains déploiements en ayant l’impression de prendre une discussion en marche, sans trop savoir ni percevoir facilement le contexte problématique dans lequel elle se déroule. Cette difficulté ne serait-elle pas atténuée si le cadre général de la « redirection » se nommait explicitement « décroissance » ? Pas n’importe quelle décroissance ; mais une décroissance politique, délivrée en particulier de l’emprise que le régime de croissance – par ses « imaginaires » et sa « forme » – exerce sur la plupart des degrowth studies, sans même parler des post-growth studies !
- La seconde concerne le dernier chapitre (le septième) consacré à « sobriété et suffisance intensive » dans lequel on trouve la suggestion de remplacer un infini en extension par un infini en intensité (page 150). Pourquoi vouloir à ce prix valider une « reprise de l’infini sous la forme de répétitions qu’aucun résultat extrinsèque n’épuise » ? Autant on peut comprendre que la critique de la mystique de la créativité passe par une révaluation de la répétition, autant on ne voit pas pourquoi cette répétition serait une figure valable d’un infini… Je retrouve à la lecture de ce chapitre la même perplexité que celle rencontrée au cours du livre pourtant si « robuste » d’Olivier Hamant, La troisième voie du vivant (Odile Jacob, 2022) quand il écrit que « l’infini a toujours été une force mobilisatrice pour les sociétés humaines » (page 173). Avons-nous vraiment besoin d’un infini pour mobiliser, voilà une question ontologiquement décroissante…
Les notes et références
- Que ce soit comme champ d’analyses ou comme temporalité.[↩]
- Compte-rendu de lecture[↩]
- Compte-rendu de lecture[↩]
- Compte-rendu de lecture[↩]
- Sur Reporterre : https://reporterre.net/Capitalisme-les-impasses-de-la-redirection-ecologique ; Sur Usbek&Rica : https://usbeketrica.com/fr/article/la-democratie-ne-consiste-pas-a-substituer-un-narratif-a-un-autre ; sur tiko//graphie : https://www.tikographie.fr/2023/04/25/politiser-le-renoncement-ou-lart-de-demanteler-les-ruines-ruineuses/.[↩]
- Rupture et continuité, ce sont les deux catégories philosophiques pour penser le temps comme « succession ». « Succession », c’est le terme notarial pour désigner l’héritage ; sauf que dans notre cas, nous ne pouvons pas « refuser la succession ».[↩]
- Pourrait ici se poser la question de la propriété personnelle, qu’il ne faut pas réduire à celle de la propriété privée.[↩]
- C’est toute la différence entre la puissance de « faire » et le pouvoir (et son abus) de « faire faire » : sur ce point voir John Holloway, Crack capitalism, ou Miguel Benasayag, Du contre-pouvoir.[↩]

