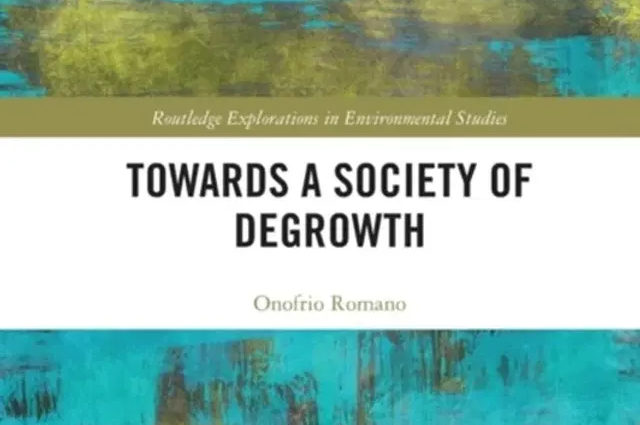Quelle est la version actuellement dominante de la décroissance au sein même de la mouvance décroissante ?
- Pourquoi la décroissance ? Parce qu’il y a des limites extérieures, qui viennent de la nature (au sens large), et qui finiront par contraindre l’économie dominante à abandonner la boussole de la croissance. Et cette réduction (structurellement économique, infrastructurellement énergétique et matérielle) entraînera la fin de la société de croissance et le passage dans une société post-croissance.
- Comment la décroissance ? Éclairé de l’intérieur par ses bonnes valeurs, l’individu plongé dans les contradictions internes du monde de la croissance en prend conscience ; il ne se contente pas alors d’améliorer sa vie personnelle mais, par la rencontre avec d’autres individus aussi conscients que lui, il s’engage dans (au moins) une des formes alternatives de vie (alimentation, production, habitation, éducation, santé…) qui préfigurent le monde d’après ; ces expérimentations concrètes essaiment au point d’atteindre une masse critique qui débouche sur une bifurcation politique à l’issue de laquelle c’est le monde entier qui bascule dans le monde d’après, celui de la sobriété, de la convivialité, du partage, de l’émancipation, en rupture avec les dominations, les exploitations, les aliénations, les emprises, les rivalités… Dans une version moins irénique, cette transition ne pourra pas se passer de converger avec les colères sociales et les moments de lutte 1.
*
Comment le décroissant mainstream va-t-il lire ces quelques extraits du livre d’Onofrio Romano, Towards a Society of Degrowth (Routledge, 2020, une traduction française bientôt à paraître chez Liber) ?
Comme nous le verrons, en fait, dans beaucoup de récits de décroissance qui circulent actuellement, la croissance est contestée, mais sans remettre en cause les fondements de l’organisation socio-institutionnelle dont elle est l’expression (page x).
Le projet de décroissance, tel qu’il se présente actuellement, peut-il aspirer à désamorcer et à inverser le régime de croissance ? Peut-il réellement viser à changer ce monde, en transformant les logiques systémiques actuelles et en promouvant une alternative sociale libérée de la contrainte de la croissance ? Notre réponse est : non (page 43).
Nous demandons à la nature de faire le sale boulot à notre place : balayer un modèle de vie contre lequel nous reconnaissons clairement que nous n’avons pas assez d’arguments politiques efficaces (pages 49-50).
Le projet de décroissance nous semble inapte à remettre en cause la complexité du régime actuel et à mettre en place une authentique alternative sociale libérée de la logique de croissance (page 54).
Notre hypothèse est que le projet de société de décroissance repose sur une contradiction interne substantielle : il laisse intact le modèle anthropologique moderne, mais l’encadre dans des formes institutionnelles qui ne peuvent pas l’accueillir à long terme (page 72).
L’imaginaire qui encadre l’homme de la décroissance est le même que celui de l’idéal-type consumériste (page 74).
Les défenseurs de la décroissance affirment qu’une architecture politique et territoriale donnée (l’architecture localiste) génère nécessairement un programme politique spécifique, celui d’une démocratie directe (écologique). Je soutiens au contraire que nous nous berçons d’illusions si nous pensons qu’une fois qu’une communauté est responsabilisée et démocratisée, elle se ralliera volontairement aux » bonnes » valeurs de la sobriété, de la phronesis, du » small is beautiful « , et ainsi de suite (pages 76-77).
Notre thèse est que la décroissance s’avère inefficace (d’un point de vue intellectuel et politique), car, au-delà de la concurrence sur les « valeurs », elle repose sur la même « forme » que celle qui encadre le régime de croissance (page 83).
A y regarder de plus près, les décroissants ne rejettent pas vraiment le cadre libéral du pouvoir politique. Ils essaient seulement de réduire les potentiels destructeurs de ce système en confinant de manière irréaliste l’action humaine au niveau local et en faisant confiance de manière irréaliste à un changement général de mentalité (page 91).
Je soutiens que nous devons passer par une décroissance du sujet moderne, plutôt que par son redoublement réflexif (page 101).
*
Ce que propose O. Romano n’est donc pas la reprise acritique de la version mainstream de la décroissance mais, tout au contraire, c’est un plaidoyer autocritique en faveur de la décroissance. Comment répond-il aux deux questions précitées ?
- Pourquoi la décroissance ? « La « croissance » n’est donc rien d’autre que le résultat et la traduction du principe moderne de la neutralité institutionnelle » (page 22). Ce principe moderne, c’est celui du « régime de croissance », et c’est un principe politique que l’on peut qualifier d’horizontaliste ou de neutraliste : c’est un régime libéral (et maintenant néolibéral).
- Avant d’y répondre, la question « Comment la décroissance ? » doit être reformulée : « Comment sortir de l’hégémonie du régime de croissance ? » (page 40). Et surtout sa réponse doit résoudre une difficulté supplémentaire, car « le projet de décroissance, dans sa formulation actuelle, ne représente pas, à y regarder de près, une véritable alternative au schéma de régulation, aux enjeux anthropologiques et au système de valeurs du régime de croissance. De multiples points de vue, il s’avère compatible avec le régime de croissance et, d’une certaine manière, il participe à sa consolidation » (page 43).
- « La forme verticale sans valeurs de décroissance peut produire plus de dégâts que l’horizontalisme. Mais, contrairement à l’horizontalisme, le verticalisme n’est pas indifférent aux valeurs. Si nous alimentons la forme verticale avec des valeurs de décroissance, nous pouvons espérer obtenir une société de décroissance. Le contraire n’est pas vrai : les valeurs de décroissance dans un cadre horizontal ne produisent pas une société de décroissance, […] parce que l’horizontalisme est indifférent à toute valeur. Nous devons donc viser un régime verticaliste encadré par des valeurs de décroissance » (page 93).
Voilà donc un livre qui va confronter directement le décroissant mainstream à un changement de donne, un game changer, toute une série de « chanvirements » ou de « perturbatures »2. Ce qui n’est pas gagné d’avance, car ce décroissant est souvent plus à l’aise dans la critique dirigée contre le monde de la croissance que dans la critique interne, cela dû à un penchant pour le relativisme, qui est précisément l’un des effets dialogiques du régime horizontaliste de croissance.
*
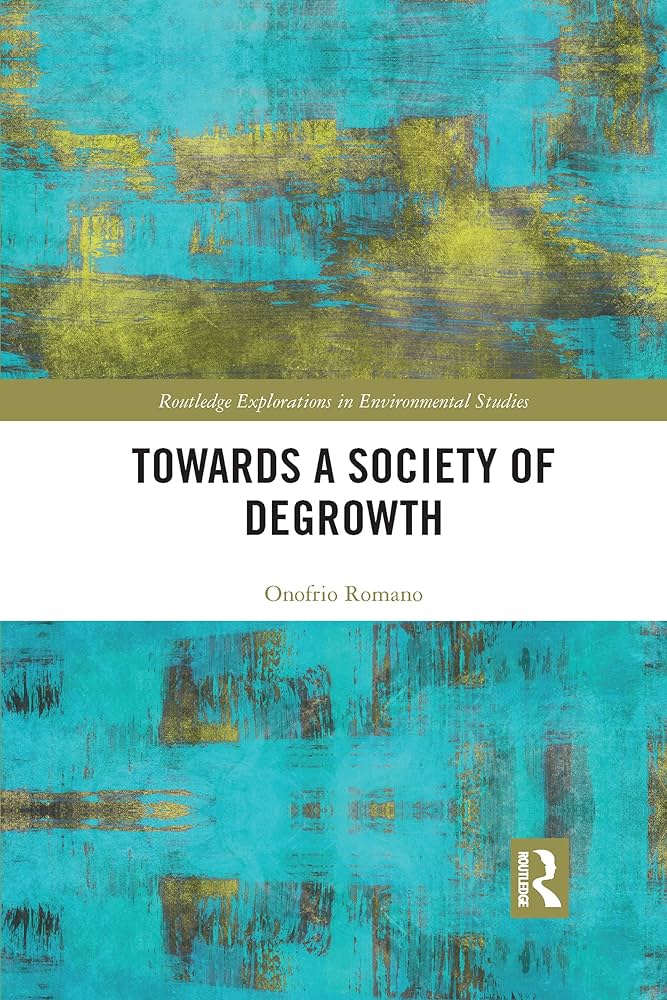
L’ouvrage se compose de quatre parties dont le fil conducteur est le suivant :
- Pour comprendre l’attachement de la société à la croissance économique, il ne faut pas en rester au symptôme, mais approfondir le diagnostic jusqu’aux causes modernes du régime de croissance (partie 1).
- On pourrait s’attendre alors à ce que la décroissance étende sa critique de l’insoutenabilité écologique et sociale jusqu’à celle du régime de croissance mais malheureusement, non seulement ce n’est pas le cas, mais par une adhésion tant anthropologique qu’institutionnelle, « il participe à sa consolidation » (partie 2).
- Il convient alors de se demander où la décroissance pourrait trouver des ressources idéologiques pour échapper à l’emprise du régime de croissance. O. Romano les trouve chez George Bataille dont la conception d’une « économie générale » repose sur l’hypothèse non pas d’un épuisement des ressources mais tout au contraire d’un état d’abondance. C’est à partir d’un tel renversement qu’il peut reconsidérer et la croissance et la décroissance (partie 3).
- A la lumière de la notion de dépense, il esquisse enfin quelques traits institutionnels et anthropologiques d’une société de décroissance, à partir d’un plaidoyer en faveur d’un retour à une forme verticale, pour permettre à un sujet « dé-pensant » de s’inscrire dans un projet politique de souveraineté par la dépense collective (partie 4).
*
Dans son plaidoyer critique en faveur de la décroissance, on ne peut pas dire que l’auteur nous prenne en traître car, dès l’avant-propos, il pose que « la croissance est le symptôme, pas la maladie » (page viii). Et cette maladie, il ne la diagnostique pas à partir « des effets directs de la croissance sur l’environnement et la santé » (page ix) mais il la trouve dans le « régime qui génère le fétichisme de la croissance » » (ibid.). Autrement dit, sa porte d’entrée dans la décroissance n’est pas écologique mais socio-institutionnelle : ce qui fait la nouveauté historique de la croissance, ce ne sont pas tant ses effets dévastateurs dirigés contre la nature, c’est l’emprise qu’elle exerce et qui rend nos vies « misérables ». Autrement dit, le péril de la croissance et de son régime n’est pas d’être une menace contre la vie, mais contre le sens de la vie. A se tromper de menace, le risque (politique) serait alors de sauver la vie tout en perdant le sens : « Pour le dire brièvement, nous pouvons sortir de la croissance sans quitter le régime de croissance » (ibid.). Et pour reprendre un jugement célèbre d’Hannah Arendt, je rajoute : on ne peut rien imaginer de pire.
Dans la première partie, Onofrio Romano répond à une question simple : d’où vient la croissance ? A en rester à une compréhension de la décroissance réduite au champ économique, la réponse devrait être cherchée dans ce moment du 20ème siècle qui va de la crise de 29 (et l’invention subséquente de l’indice du PNB) jusqu’aux fameuses trente glorieuses (et qui va voir la croissance devenir la boussole d’une course géopolitique entre les deux blocs dominants de l’après-guerre)3. Mais son propos est précisément de ne pas s’arrêter à cette réduction de la croissance à l’économie et d’aller chercher la « légitimation sociale de la croissance » (page 15) aux sources mêmes de la modernité et de son projet libéral. Car ce n’est pas le régime de croissance qui est un effet pervers de la croissance économique mais c’est historiquement l’inverse : la croissance comme boussole macroéconomique n’est que le résultat de la pente fatale du régime de croissance.
Qu’est-ce alors que ce « régime de croissance » ? Peut-on ramener cette notion à ce qu’Herman Daly, puis Matthias Schmelzer, nomment « paradigme de croissance », ou à ce que Serge Latouche nomme « société de croissance » ? Socio-anthropologiquement, pourquoi pas ; car, sous cet angle, le régime de croissance peut apparaître comme le nom du projet moderne d’individualisation, de rationalisation, d’occidentalisation, c’est-à-dire comme cette entreprise d’explication et de justification d’un monde dont le centre de gravité n’est plus la vie communautaire mais la vie individuelle. La vie en société n’apparaît plus alors que comme « le résultat involontaire de l’interaction entre les acteurs individuels » (page 22) ; ou : « la tension vers la croissance est le résultat fondamental de l’individualisation » (page 6)
Mais on passerait à côté du véritable apport politique de cette notion si on en restait à cette « institution imaginaire de l’individu » (page 10). On passerait à côté de la dimension institutionnelle. Car la « société » ne peut devenir un résultat « involontaire » que si et seulement si les institutions modernes mises en place par la modernité se plient à une « forme », pas n’importe laquelle mais la forme de l’horizontalisme. Analytiquement, cela veut dire que pour comprendre une société, il suffirait de se référer aux stratégies individuelles. Mais politiquement, cela veut dire que l’idéal serait de « laisser-faire » les individus : d’où le devenir-neutraliste de tout horizontalisme. Les institutions modernes n’imposent plus de façon descendante une conception de la vie bonne, mais c’est à chacun de s’auto-construire.
« En résumé, dans le régime de croissance, un pouvoir a-téléologique public est installé, qui ne se mêle jamais de la question de ce qu’est une vie bonne, parce que la vie sociale doit être considérée comme le résultat involontaire de l’interaction entre les acteurs individuels. Ceux-ci sont souverains dans l’élaboration et la réalisation de leur propre part de vie. La politique a pour seule fonction de préserver, voire de cultiver, la vie « biologique » des citoyens, ainsi que la régulation administrative de leur libre circulation. La » croissance » n’est donc rien d’autre que le résultat et la traduction du principe moderne de neutralité institutionnelle » (page 22).
Dans cette première partie, O. Romano multiplie les références (Max Weber, Norbert Elias, David Riesman, Jean Baudrillard, Karl Polanyi, Mauro Magatti) pour montrer que la croissance (économique), l’horizontalisme (institutionnel), l’individualisme (social), le neutralisme (politique) ne sont que les facettes d’un même dispositif caractéristique de la modernité. Mais, il faudra attendre la troisième partie, et la référence à George Bataille, pour vraiment expliquer le lien intrinsèque entre individualisme, croissance, et économie définie par la rareté.
O. Romano finit cette première partie en dressant un inventaire des « principales conséquences néfastes du régime de croissance dans les domaines de l’économie et de l’écologie, des institutions et de la politique, de la psychologie et de la socio-anthropologie ».
*
La deuxième partie est une présentation critique de la décroissance. Même si ce n’est pas très facile à lire, en particulier parce que l’enchaînement de ses chapitres n’est pas toujours évident, son idée directrice est simple à dégager. En creux, il s’agit de préparer les deux parties suivantes qui proposeront un recadrage conceptuel fort de la décroissance (partie 4) à partir de l’apport de George Bataille (partie 3). D’où la mise en relief des insuffisances sinon des incohérences de toute une série d’analyses et de mouvances qui font plus ou moins route avec la décroissance sur le chemin des transitions. Insuffisances qui font particulièrement ressortir l’ambiance brouillardeuse et embrouillée dans laquelle la décroissance évolue depuis ses origines : car il faut comprendre que si O. Romano écrit qu’il existerait bien une « structure de base consolidée » (page 31) de la décroissance, cette partie va montrer que ce « socle commun » repose malheureusement sur le même fond neutraliste que le régime de croissance.
Sont ainsi « égratignées » différentes « variations » plus ou moins convergentes de et avec la décroissance : l’anti-utilitarisme (Alain Caillé et le MAUSS), les scénarios de transition par essaimage, le programme des « huit R » (Serge Latouche), la mode de la catastrophologie.
Nous devons alors nous poser quelques questions dérangeantes : est-ce que ce « socle commun » de la décroissance existe ? Et si oui, que contient-il ? Quand Onofrio Romano, dans cette deuxième partie, passe en revue un certain nombre de thèses largement répétées dans la mouvance décroissante, suivons-le mais en les présentant dans un ordre qui va de la plus robuste à la plus problématique :
- La critique socio-anthropologique de l’individualisme : réactivement, tout décroissant dénonce la réduction utilitariste des humains à des êtres gouvernés par la seule logique du calcul intéressé entre leurs plaisirs et leurs préférences. Positivement, ils défendent « l’importance cruciale du lien social par rapport à l’intérêt personnel » (page 32).
- La critique de l’insoutenabilité tant écologique que sociale (page 34). La croissance dans ce cas n’est pas que la croissance économique du PIB mais aussi celle de la marchandisation des services qui dans une société font lien. Ce qu’à la MCD nous appelons les effets écocidaires et sociocidaires de la croissance.
- D’où une définition très partagée de la décroissance comme « réduction » de la production et de la consommation, et donc des extractions et des déchets. Autrement dit, la diminution du PIB n’est pas un objectif de la décroissance, mais l’effet économique probable d’« un mode de vie plus convivial et respectueux de l’humain » (page 37).
- C’est Serge Latouche, par son programme des « huit R », qui formule le plus explicitement ce que pourrait être le « schéma d’une société décroissante » : reconceptualiser, réévaluer, restructurer, redistribuer, réduire, réutiliser, recycler, relocaliser. Remarquons que si cette deuxième partie expose ces « huit R », c’est dans l’Appendice qui retranscrit un dialogue entre Serge Latouche et l’auteur que ce dernier en livre une appréciation sévère4 : « j’ai l’impression que la décroissance risque de se traduire par une affirmation quasi absolue, totalitaire et exclusive de l’esprit utilitaire. Je me réfère, notamment à votre programme des « huit R ». Eh bien, je n’y vois rien d’autre qu’une perpétuation de la substance utile des objets » (page 116).
- Cet utilitarisme au sein de la prétention anti-utilitariste de la décroissance se traduit dans une définition de la décroissance comme défense de « la vie pour la vie ». Or une telle défense du « caractère sacré de la vie » (page 49) ne peut s’effectuer qu’à condition de reprendre le programme de la modernité, à savoir ne pas se préoccuper du sens de la vie ; ou plutôt, en faire une affaire strictement privée, les institutions de la modernité ne devant se consacrer qu’à la fourniture des moyens matériels et juridiques pour maximiser les chances de chacun de construire son propre projet individuel de vie. Autrement dit, la maximisation des conditions de « la vie pour la vie » revient à « la croissance pour la croissance » (page 49).
- Alors si « la croissance n’est que la traduction prosaïque, triviale, neutre, historique et stylisée de la pulsion de manifestation illimitée de soi : avoir plus multiplie mes chances d’être ce que je veux être » (page 44), comment juger une décroissance qui resterait bloquée « sur le principe cardinal de la modernité, autrement dit qui s’inscrirait dans le programme horizontaliste donc neutraliste du régime de croissance, par la défense de la vie elle-même, quel que soit le sens de la vie » (page 46), ?
- Il ne faut alors pas s’étonner de lire une irritation grandissante de l’auteur quant au devenir « impolitique »5 de la décroissance : « Nous demandons à la nature de faire le sale boulot à notre place : balayer un modèle de vie contre lequel nous reconnaissons clairement que nous n’avons pas assez d’arguments politiques efficaces » (pages 48-49).
- Il ne faut alors pas s’étonner que l’auteur en vienne à faire descendre la décroissance de son piédestal d’opposition à la croissance : « Le projet de décroissance, tel qu’il se présente actuellement, peut-il aspirer à désamorcer et à inverser le régime de croissance ? […] Notre réponse est : non » (page 43).
- C’est à cause de cette dévotion maintenue en faveur de l’horizontalisme et du neutralisme que beaucoup de décroissants se leurrent sur ce que serait une transition décroissante. En adhérant à la forme neutraliste du régime de croissance, ils ne font pas attention que cette forme est politiquement un dispositif de neutralisation et que par conséquent, il est bien illusoire de croire que les alternatives concrètes, à cause de leur exemplarité dans la pratique de « valeurs », puissent essaimer. Le changement est imaginé comme la promotion ici et maintenant de « valeurs » anti-croissance en mettant en scène des alternatives sociales à partir de la base et en radicalisant leur forme horizontale (page 41). Car même si « nos » valeurs sont « exemplaires » pour une « élite consciente », il ne faut pas oublier que dans un « régime d’équivalence universelle » (page 48), « nos » valeurs ne valent pas plus que leurs contraires.
- Parce que le régime neutraliste de croissance est un système d’équivalence généralisée, alors la question collective du sens de la vie n’est plus jamais posée, elle n’est plus une « préoccupation » moderne.
« Or, une communauté ne peut être « vraiment démocratique » que si elle débat du sens et si elle permet de créer collectivement une idée de la « bonne société », en la mettant en œuvre concrètement » (page 50). Finalement, à ne pas faire de la question du sens de la vie une question politique, la décroissance volontaire non seulement « reste bloquée dans le paradigme de la neutralité, visant la survie biologique, quel que soit le sens de la vie » (page 51) mais elle risque de dériver à son insu vers la tentation anti-démocratique de la catastrophologie (page 48).
Devant une telle dénonciation des illusions de la décroissance sur elle-même, en particulier dans son indifférence à l’emprise que le régime de croissance exerce sur ses analyses, on en vient à se demander comment l’auteur peut maintenir un projet Towards a Society of Degrowth.
*
La troisième partie propose de repenser la décroissance par la dépense. C’est en effet dans les réflexions de Georges Bataille (1894-1962) qu’Onofrio Romano va trouver la matrice pour « inverser » (page 55) un grand nombre de pensées décroissantes, ce qui lui permettra ensuite de reformuler complètement le projet d’une société de décroissance (dans la partie 4).
La principale « inversion » porte sur la définition même du « problème fondamental » de la décroissance. Pour la décroissance mainstream¸ c’est celui de la rareté. D’où le fameux slogan qu’une croissance infinie est impossible dans un monde fini. Pour Bataille, le malheur n’est pas que nous manquions de ressources, c’est que nous ne savons plus organiser leur abondance, c’est que nous ne savons plus nous organiser pour dépenser (collectivement) les surplus. Pour le dire de façon encore plus provocante : ce que nous ignorons, ce n’est pas économiser, c’est gaspiller.
Pour rendre compte d’un tel renversement, O. Romano est obligé de fournir quelques éléments de la philosophie générale de Bataille ; mais il faut reconnaître que le lien avec la décroissance n’est pas évident. Et pourtant, il y a en a un, qui aurait être plus explicitement thématisé ; quel est en effet le lien entre dénonciation du régime de croissance et économie de la rareté ? A première vue, il paraît contradictoire de défendre en même temps la croissance et la rareté. Et c’est cette contradiction que croit relever la décroissance quand elle s’engouffre dans une reprise acritique de l’économie comme gestion de la rareté, sans voir que la course à la croissance n’est qu’une mauvaise réponse à un faux problème mais à une vraie angoisse, celle « générée par le surplus » (page 68), par « l’excès d’énergie » (page 98), par l’abondance.
« En principe, l’existence particulière risque toujours de manquer de ressources et de succomber. A cela s’oppose l’existence générale dont les ressources sont en excès et pour laquelle la mort est un non-sens. A partir du point de vue particulier¸ les problèmes sont en premier lieu posés par leur l’insuffisance des ressources. Ils sont en premier lieu posés par leur excès si l’on part du point de vue général ».
Georges Bataille, La part maudite (1949, 1967), Points, page 81.
Pour Bataille, le malheur de la modernité c’est la victoire (horizontaliste) du point de vue particulier sur le point de vue général (et donc le recul de la priorité verticale du général sur le particulier). Là où auparavant la « totalité » enchantait les vies humaines – tant dans un sentiment de continuité entre nature et culture que dans un sentiment de proximité communautaire – les temps modernes qui sont le temps de la « désintégration de la totalité » (page 57) ont perdu le sens de la réponse pré-moderne.
Car il y a en effet deux modes bien distincts de consommer : dans le premier, il faut d’abord satisfaire les besoins vitaux ; la consommation est alors une activité servile, au service de « la vie pour la vie ». Dans le second, il importe de dépenser hors de toute finalité productive ou reproductive.
Dit autrement : il y a deux façons de dissiper l’énergie. Une première part (« servile ») est absorbée pour la conservation de la vie. L’autre part (« maudite ») consiste à la dépenser.
C’est là qu’il faut retrouver les deux façons de penser l’économie. Car du point de vue tronqué du particulier, c’est la rareté qui commande. Mais du point de vue général, il y a en réalité toujours abondance et excédent d’énergie et se pose donc la question : une fois la part servile satisfaite, qu’est-ce qu’on fait du surplus ?
« Dans le domaine de l’activité humaine, le dilemme prend la forme suivante : soit la plupart des ressources disponibles (c’est-à-dire le travail) sont utilisées pour fabriquer de nouveaux moyens de production – et nous avons l’économie capitaliste (accumulation, croissance de la richesse) – soit le surplus est gaspillé sans essayer d’augmenter le potentiel de production – et nous avons l’économie festive » (page 59).
Ce qu’O. Romano nomme « économie festive » consisterait donc, une fois la subsistance de la vie garantie6, à laisser la dépense se dissiper aux travers de toute une série d’usage ou de fonctions qu’il analyse l’une après l’autre : fonctions symbolique, sacrificielle, connective, souveraine, pure (destructrice) (pages 62-65).
Si la décroissance adoptait l’inversion des points de vue sur l’économie, elle nous mettrait en tant qu’humains au pied du mur, celui du sens : car « En utilisant l’énergie excédentaire, nous nous qualifions en tant qu’êtres humains » (page 59).
- Ce que ne fait évidemment pas le régime individualiste de croissance. Dans lequel, la réponse individualisée va consister « en croissance morale, intellectuelle et civile. Plus de dépenses, plus de gaspillage vulgaire, mais une recherche active d’un sens moral à attacher à son parcours terrestre. Le sujet moderne, déjà chargé du poids insupportable du surplus, est alors invité à utiliser le temps extra-servile pour son perfectionnement moral » (page 67). C’est ainsi que le régime de croissance s’individualise en développement personnel.
- Quant aux réponses sociales apportées par le défi de la dépense sensée des excédents, O. Romano en souligne trois : évidemment, d’abord « la croissance pour la croissance ». Deuxièmement, le régime neutraliste : puisque la construction collective du sens est expulsée de l’espace public, alors « il appartiendra aux individus, avec leur libre arbitre, de décider comment utiliser le surplus et donc quel sens ajouter à leur parcours existentiel » (page 69). Troisièmement, la privatisation des surplus au profit d’une extrême minorité (qui affiche maintenant de façon ostentatoire ses excès).
A ce point d’analyse, on se prend à penser que la décroissance va assumer de prendre le contrepied de toutes ces solutions croissancistes et repenser la décroissance à la lumière de la dépense.
Et bien non, à une exception près7.
« La dépense est donc un concept clé pour penser la sortie de la société de croissance. Paradoxalement, elle ne figure pas parmi les piliers épistémologiques de la réflexion théorique dominante sur la décroissance, pas plus qu’elle n’est une source d’inspiration pour les mouvements de contre-croissance. La seule exception pertinente est représentée par les éditeurs du Vocabulaire de la décroissance (D’Alisa et al., 2014) qui, dans leur postface ( » De l’austérité à la dépense « ), suggèrent d’adopter la dépense comme un outil pivot pour la théorie et la pratique de la décroissance, défiant les perplexités et le mécontentement d’une large part du mouvement. Manifestement, leur généreuse tentative n’a pas été suivie et probablement pas même comprise » (page 71).
Citons aussi Giorgos Kallis, l’un de ces éditeurs précités qui dans son Éloge des limites, demande de reconsidérer la croissance et donc sa critique décroissante non pas du point de vue de la rareté mais du point de vue de l’abondance ; ce qu’il écrit sur les limites est sans ambigüité :
« Je pense effectivement qu’il n’existe pas de limites extérieures… La limite relève d’un choix, et c’est le type de monde que nous souhaitons créer et transmettre à nos enfants qui doit nous permettre de la définir. Nous n’avons rien à gagner à attribuer ce choix à la nature. »
Giorgos Kallis, Éloge des limites (2019, trad. 2022), PUF, pages 179-180.
Pour le reste, le récit dominant chez les décroissants en reste à la « posture servile », celui de la rareté des ressources comme problème économique. Il ne faut pas alors s’étonner si O. Romano n’a guère de mal, en conclusion de cette troisième partie, à montrer que l’homme des « huit R » n’est « rien d’autre que l’ »homme moderne » » (page 72), que la décroissance définie comme « « réduction » n’est pas un coup bas contre le démon du productivisme mais le cheval de Troie de la rationalisation intégrale » (page 73), « La contradiction est encore plus flagrante si l’on examine les valeurs sociales sous-jacentes à la proposition de décroissance » (page 76) : car ces « bonnes » valeurs, au lieu de rejeter le pacte moderne entre libéralisme, individualisme et croissance se satisfont trop vite de proposer une « « bonne » modernité des origines comme thérapie à la « mauvaise » modernité » (page 78).
Toutes ses incohérences de la théorie mainstream de la décroissance reposent finalement sur une illusion : c’est que dans un régime horizontaliste de croissance, les bonnes valeurs ne peuvent pas ne pas finir démocratiquement par l’emporter. Pire, même si les bonnes intentions de cette théorie consistent certainement à ne pas vouloir laisser les hommes en face du « vide de la vie » (page 79), il n’empêche que la dévotion à la forme horizontaliste ne peut aboutir qu’au renforcement du désenchantement généralisé.
Comment alors retrouver dans un même élan décroissance, dépense et réenchantement, comment redonner du sens collectif à notre système social ?
*
La quatrième partie traite d’un programme politique décroissant. O. Romano reconnaît d’emblée que celui évoqué par George Bataille n’est ni faisable8 ni même « souhaitable » (page 83). Il n’en abandonne pas pour autant l’idée quand il propose de construire cette dernière partie autour de 3 points : le cadre institutionnel ; la stratégie politique, le cadre anthropologique.
Sans surprise, le cadre institutionnel qu’O. Romano propose à la décroissance va s’appuyer sur « la restauration d’un nouveau régime vertical » (page 91). Comment le justifier ? Car d’un côté O. Romano n’ignore pas que « 40 ans de néolibéralisme frénétique et de capitalisme techno-nihiliste ont érodé les fondements de la société » (page 108) et ont abouti à identifier verticalisme et « traumatisme » (page 90), et surtout ils se sont ajoutés aux dangers bien connus du verticalisme, « nationalisme, autoritarisme et réclusion ethnique » (page 110) ; et d’un autre côté, tout son livre est une déconstruction systémique du régime horizontaliste de croissance.
Sans être labyrinthique, le plaidoyer en faveur d’un régime verticaliste de la décroissance n’est pas vraiment un trajet direct :
- Double définition succincte du verticalisme. Dans la sphère sociale, le moteur n’est pas l’individu mais une « intentionnalité centrale…placée au-delà des interactions humaines » ; dans le champ théorique, « pour comprendre la vie sociale, il faut localiser et décoder cette intelligence descendante (top-down), qui sous-tend l’ensemble du système » (page 84).
- O. Romano consacre alors plusieurs pages à réexposer9 et à justifier historiquement ce qu’il appelle « une sorte de « loi d’alternance croisée » entre la régulation sociale et la pensée ». Ce qu’il veut dire par là c’est qu’il ne faut réduire le paradigme formel de la modernité ni au verticalisme ni à l’horizontalisme. Ce qui caractérise la modernité c’est une relation chiasmatique entre verticalité / horizontalité et structure sociale / pensée sociale : quand une forme régule la société alors elle est contestée par l’autre forme, et vice-versa. Une telle « hypothèse de travail » lui fournit alors une clé pour « reconsidérer les principales phases de la modernité occidentale » (page 85). 1815-1929 : âge d’or de la sociologie / marché autorégulateur. 1930-1980 : microsociologie de l’individu-acteur / État redistributeur redevenu moteur économique et social.
- Mais « le jeu traditionnel entre les modèles de pensée et de gouvernement (la loi de l’alternance croisée) ne fonctionne pas dans la crise actuelle, commencée en 2008 et qui fait toujours rage. La société horizontaliste née au début des années 1980 (du siècle dernier) est en panne, mais un nouveau paradigme (verticaliste ?) n’a pas encore été préparé. Nous sommes face à un « retard de paradigme » » (page 89).
- Or c’est dans ce retard de paradigme que la décroissance s’est engouffrée : en se conformant elle-même à l’horizontalisme, elle ne vient pas du tout s’opposer au néo-horizontalisme dominant socio-économiquement mais elle vient juste redoubler l’horizontalisme. Pire, là où le néo-horizontalisme du néolibéralisme est en crise (depuis 2008) sur le plan fonctionnel, « il est en pleine forme sur le plan socioculturel » (page 90).
- Pourquoi la décroissance commet-elle un tel contresens politique ? Parce qu’aveuglée par sa dévotion à l’horizontalisme, elle attribue cette crise aux « valeurs » promues par le néo-libéralisme et non pas à la « forme » du régime de croissance. Du coup, elle s’illusionne « au carré » (en échouant et en renforçant), parce qu’elle croit qu’elle doit mener son combat au nom de « ses » valeurs. Alors qu’en régime horizontaliste de croissance, toutes les valeurs et contre-valeurs s’équivalent !
« Dans ces conditions structurelles, la dimension éthique se révèle totalement inoffensive pour le régime horizontal, qui favorise plutôt la prolifération illimitée de valeurs et de significations, même réciproquement antithétiques. Il est donc incongru de lui opposer des valeurs. Il faut donc déplacer la lutte pour une société de décroissance des valeurs à la « forme », en abandonnant la dévotion au cadre horizontal » (page 93).
Comment justifier une telle inversion de « forme » ? Pour une raison qui peut sembler paradoxale mais qui est en réalité logique : quelle est la forme, verticaliste ou horizontaliste, qui peut redonner sens et force aux valeurs ? Quand la forme est horizontaliste, toutes les valeurs se valent. Ce n’est que dans un régime verticaliste que les valeurs peuvent retrouver de la force. Cela ne veut pas dire que n’importe quel régime verticaliste sera compatible avec les valeurs de la décroissance : « la forme verticale sans valeurs de décroissance peut produire plus de dégâts que l’horizontalisme. Mais contrairement à l’horizontalisme, le verticalisme n’est pas indifférent aux valeurs 10. Si l’on nourrit la forme verticale de valeurs de décroissance, on peut espérer obtenir une société de décroissance » (ibid.).
Quelle stratégie verticale de transition ?
Comment sortir la décroissance de l’ornière transitionnelle qu’elle s’obstine à vouloir creuser sous la forme de l’essaimage, par la simplicité volontaire et les alternatives concrètes ?
« Nous ne sommes pas du tout d’accord avec cette voie. Au contraire, nous pensons que (1) nous ne devons pas partir de nous-mêmes, c’est-à-dire de l’élite (en espérant que tout le monde nous copiera), mais des sentiments, des besoins, des désirs des personnes réellement (c’est-à-dire en essayant de greffer une alternative de décroissance dans les processus sociohistoriques) ; (2) la relation entre les citoyens et les institutions doit être encadrée dans une forme verticale afin de mettre en place une véritable alternative de décroissance, c’est-à-dire une société « souveraine » libérée du servilisme » (ibid.).
Pour relever ce défi O. Romano va s’appuyer sur une situation historique (encore une fois) sur laquelle il va braquer le projecteur explicatif de la dépense et du refus de la servilité. Cette situation c’est le « passage, entre la fin des années 70 et le début des années 80 (du siècle dernier), des Trente Glorieuses sociales-démocrates aux Trente Inglorieuses néolibérales » (page 95) : c’est un moment décisif parce que, en termes batailliens, nos sociétés modernes s’y sont trouvées au seuil de la souveraineté. En effet, on peut dire que le « succès » des trente Glorieuses avait « permis aux peuples occidentaux de résoudre le problème de la survie et d’échapper ainsi à la dimension « servile » » (page 96). Le servilisme surmonté, a surgi alors la question souveraine : que faire des excédents ?
Nous savons tous que la réponse n’a pas été décroissante mais néolibérale. Comment d’ailleurs la réponse aurait-elle pu être décroissante puisque la décroissance à ce moment s’engouffre déjà dans la prison de la rareté, et donc de la servilité11 ? La réponse néolibérale a été une hystérisation de la croissance, de l’individualisation, de la dévaluation horizontaliste de toutes valeurs « socialisantes ». Selon O. Romano, cette accélération néolibérale a reposé sur deux piliers :
- Le premier a consisté dans ce qu’il appelle une « politique de précarisation mobilisatrice » (page 97). Le néo-libéralisme surfant sur la vague néo-horizontaliste en a profité pour démanteler toutes les structures institutionnelles verticales provenant de l’État-Providence ; cette stratégie a visé « délibérément à effacer la protection sociale, à précariser à nouveau la vie des citoyens pour les remobiliser » (page 97). Chaque individu, renvoyé de nouveau à la servilité de sa survie12, est alors poussé à cultiver des penchants antisociaux, des passions tristes.
- Deuxièmement, les politiques de dérégulation, de privatisation ont constitué des matrices pour déverticaliser l’État dans le champ social (tout en tenant dans le champ « sociétal » un double discours, à la fois de libéralisation des mœurs et de retour de l’autorité). Autrement dit, l’État a assumé de moins en moins sa tâche redistributrice, pour, tout au contraire, se mettre au service de la fable libérale du mérite et garantir une distribution de plus en plus inégalitaire des revenus, en faisant de la dépense des surplus le privilège d’une minorité.
Une politique verticaliste de décroissance devrait s’opposer radicalement à ces deux piliers : « Sans un système vertical, il est impossible d’imaginer une distribution égale des ressources habilitantes au plus grand nombre de citoyens » (page 98).
- Cesser d’atomiser le citoyen : lui garantir des droits, le resécuriser, le sortir de la concurrence individualisante du chacun pour soi (de ce point de vue, je ne cache pas que la critique d’O. Romano (page 45) contre le revenu de base me semble pâtir d’une ignorance de ce qu’est la revendication décroissante d’un revenu inconditionnel13 comme reconnaissance inconditionnelle de l’appartenance et de la participation de tout individu à une totalité communautaire qui le dépasse). Dans le champ des « activités », sortir de la logique moderne de la « différenciation structurelle » (la division sans fin du travail), et pour cela, instaurer ce que j’ai appelé une « indivision sociale » des activités (basée sur des principes de rotation et d’inefficacité)14.
- Pour s’opposer à la privatisation des surplus, « Il faut au contraire redécouvrir le verticalisme institutionnel pour inverser complètement la formule sur laquelle repose le néolibéralisme : de la précarisation mobilisatrice + dépense privée à la désactivation protectrice + dépense collective » (page 100). A moins de croire à une sorte de main invisible cool qui répartirait de façon juste les surplus, seule une institution verticale semble en mesure de renverser la situation. Dans le Vocabulaire de la décroissance, se trouve une excellente formulation de ce renversement : puisque « même dans une société de sujets frugaux dotée d’un métabolisme réduit, il y aura toujours un excédent, qui devra être dépensé si l’on veut éviter de réactiver la croissance », alors « le binôme sobriété personnelle/dépense sociale doit remplacer le binôme austérité sociale/excès individuel ». Voilà la question politique propre à éviter aux décroissant.e.s toute rechute dans l’individualisme : « Il nous faut réfléchir aux institutions qui seront responsables de la socialisation de la dépense improductive et des manières dont les surplus en circulation seront limités et épuisés » (Épilogue).
La fin du livre se conclut sur le cadre anthropologique. O. Romano y lance plus des pistes qu’il ne les approfondit. Son objectif est simple : comment éviter à la décroissance de dégringoler au bas de la pente fatale de l’horizontalisme, en particulier en survalorisant les stratégies de simplicité volontaire qui peuvent être critiquées comme les voies d’un « redoublement » (page 101) réflexif du sujet, comme la promotion d’un individu « au carré » (page 102) ? Bref comme opérer une décroissance du sujet moderne ?
- Dégonfler le sujet moderne : arrêter de faire reposer la décroissance sur un sujet décroissant identifié à un « saint », membre d’une « élite » qui devrait servir d’exemple à la communauté à laquelle elle appartient. Tout à l’inverse : « C’est le sujet qui accepte de dégonfler sa propre vision, le sujet qui pourrait également accepter et mettre en œuvre la vision construite par la communauté à laquelle il appartient. De même, seul un sujet qui accepte « d’être toujours moins » peut également accepter « d’avoir toujours moins », c’est-à-dire d’entreprendre un parcours de décroissance. Pour parvenir à la décroissance et à la récupération de la souveraineté collective, nous devons miser sur un nouveau modèle de subjectivité. Le développement de cette nouvelle subjectivité doit être la première bataille des décroissants » (page 102).
- Mais où un tel sujet habite-t-il ? Pour éviter de retomber dans les errements d’un homme nouveau comme support d’une révolution à venir, O. Romano évoque à la fin de son livre deux pistes géographiques, celle de l’autre Afrique et celle de la méditerranée. Dans les deux cas, la référence à la décroissance comme désoccidentalisation du monde (Serge Latouche) est présente. Dans les deux cas, il s’agit plus d’un « pari » (là aussi Serge Latouche) que d’une certitude.
- Pour l’autre Afrique : « La société informelle n’est pas le passé du marché, mais son avenir. Le domaine social y récupère la souveraineté perdue sur la vie de ses membres, y compris par des formes originales de confrontation démocratique, comme la « palabre » » (page 104).
- Pour la méditerranée : de fait, historiquement « le méditerranéisme fait avant tout allusion à la multiplicité en tant que valeur en soi : la coexistence historique accidentelle de multiples modes de vie dans un seul bassin devient la conception délibérée d’un horizon politique de convivialité » (page 106). Surtout, pendant des siècles, la méditerranée a moins été la terre du milieu qu’une « périphérie » qui a produit « une construction « anti-identitaire » de la subjectivité, c’est-à-dire une stratégie de l’absence » (page 107), par un dégonflement de l’identité comme injonction à s’auto-définir.
- Dans les deux cas, O. Romano promeut « sur la scène politique un modèle de protection qui place en son centre la préservation de l’équilibre naturel (et donc la décroissance), ainsi que l’auto-institution de la société, c’est-à-dire le retour de la souveraineté collective et d’une véritable démocratie » (page 109).
Quand la consommation se focalise sur la seule dimension utilitaire, elle se servilise. A contrario, on peut en déduire qu’en faisant de la dépense un objet de palabre démocratique, une société retrouve de la souveraineté : « en tout état de cause, retrouver la confiance dans la dépense est la condition nécessaire à la construction de la future société de décroissance » (page 111). Ce qui implique de confronter la décroissance avec la question du protectionnisme, « malgré sa mauvaise réputation » (page 110). C’est une piste, l’une de ces « questions difficiles » dont on attend qu’une théorie de la décroissance s’empare…
*
Bref un livre court mais dense et perturbateur ; parce que son sujet l’est dans la mesure où son ambition est quand même de confronter la théorie décroissante à ses apories : car, enfin, à quoi sert-il de rester groupusculaire si c’est pour se priver, en plus, d’un véritable socle cohérent ? Sauf à se raconter que la décroissance n’est pas groupusculaire (et dans ce cas-là, vogue la galère, et remettons à toujours plus tard le travail théorique) alors chacun à la fin du livre, devrait avoir compris que le véritable « socle commun » (dont a besoin la décroissance politique ← ce qui n’est pas le cas si on en reste à la décroissance-agrégat) ne peut pas se satisfaire de la forme horizontaliste actuelle.
Par-delà un tel contenu renversant, la difficulté du livre provient aussi, il ne faut pas le cacher, de sa fabrication : car s’il est une synthèse, ses éléments proviennent « académiquement » d’articles dont la décroissance n’était pas toujours le fil directeur. D’où l’attente d’un prochain livre dans lequel certains tiroirs complémentaires ne seront ouverts que par allusion et qui du coup prendra souverainement la décroissance comme ossature centrale.
Par rapport aux recherches et aux analyses de la Maison commune de la décroissance (la MCD) en France, beaucoup de convergences, jusque dans la terminologie découverte chacun de son côté, et donc beaucoup de discussions :
- Le régime neutraliste de croissance est un dispositif de neutralisation politique qui vise tout particulièrement à éjecter la question du sens du débat public. D’où l’appel pour politiser une décroissance comme théorie politique du sens. Refaire de cette question du sens une question politique.
- Ce dispositif de neutralisation a pour effet de rendre équivalentes toutes les valeurs. Est ainsi expliqué ce qu’à la MCD nous appelons le « plouf », c’est-à-dire cette performativité horizontaliste à produire du silence même après que les données les plus vraies et les valeurs les plus belles aient nourri un plaidoyer en faveur de la décroissance. Lors d’une table ronde, le décroissant peut fournir le « meilleur argument », ses partenaires continuent leur propos comme si de rien n’était, le dialogue des sourds.
- Restent enfin quelques questions à controverser :
- Le regret tout d’abord qu’O. Romano mette sous le même terme de décroissance et le trajet et le projet.
- Une interrogation forte sur la façon de tenir ensemble et la critique anti-utilitariste et le plaidoyer en faveur de ce que l’on appelle aujourd’hui « subsistance ». Comment la juste critique de la servilité utilitaire (pensons particulièrement à la tyrannie de la commodité dès qu’il s’agit de technique) ne se contredit pas avec la juste critique de la conception libérale de liberté comme « délivrance » (des conditions matérielles et sociales de la vie en commun) ?
- Une demande pour distinguer deux types de verticalité, l’une descendante, l’autre ascendante. Car ce qu’O. Romano évoque comme « pensée enracinée » (page 94) nous semble pouvoir être la matrice d’une verticalité ascendante qui peut renvoyer dos à dos et les errances de l’horizontalisme et les traumatismes de la verticalité. C’est cette « pensée enracinée » dont nous défendons l’exercice quand nous défendons le « militant-chercheur » comme une « méthode »15.
Les notes et références
- Pour une description plus analytique des scénarios et stratégies possibles, voir la recension que j’ai faite du livre de Jérôme Baschet, Basculements (https://decroissances.ouvaton.org/2022/07/11/jai-lu-basculements-de-jerome-baschet/).[↩]
- Suivant les innovations heureuses de la traductrice canadienne Audrey PM,[↩]
- Pour une genèse historique de la croissance comme « boussole » économique, il faut lire Matthias Schmelzer, The Hegemony of Growth, The OECD and the Making of the Economic Growth Paradigm (2016), Cambridge University Press (non traduit en français).[↩]
- Pour une justification systématique de la critique de chacun des « huit R », Onofrio Romano, « Les enjeux anthropologiques de la décroissance », in Baptiste Mylondo (dir.), La décroissance économique. Pour la soutenabilité écologique et l’équité sociale (2009), Éditions du Croquant, coll. « Ecologica ».[↩]
- Onofrio Romano, The impolitic narrative of grassroots movemnts against neoliberal de-politicization, PArtecipazione e COnflitto, The Open Journal of Sociopolitical Studies, Issue 10(2) 2017: 493-516.[↩]
- Cette clause est essentielle car la stratégie néolibérale consistera précisément à préconiser des stratégies de « précarisation mobilisatrice », c’est-à-dire à empêcher les individus des sociétés de la modernité tardive à se poser la question de la dépense des surplus, ce qu’O. Romano explique très bien dans sa quatrième partie.[↩]
- En France, la Maison commune de la décroissance (MCD) espère que la densité de ces analyses, en faveur de ce qu’elle appelle « le défi méditerranéen », lui permettra d’être reconnue en tant que deuxième exception.[↩]
- Le programme politique de Georges Bataille est un ascétisme, réservé à une élite ; la seule capable de supporter cette « expérience intérieure » qui finit dans « la fusion de l’objet et du sujet, étant comme sujet non-savoir, comme objet l’inconnu » (L’expérience intérieure (1943, 1954, 1977), TEL, page 21). Pour autant, un programme politique articulé autour de la dépense se devrait d’explorer « ces soudaines ouvertures au-delà du monde des œuvres utiles » (La souveraineté (20212), Lignes, page 51) : le rire, la poésie, l’art, le sacré, la beauté…[↩]
- Onofrio Romano, The sociology of knowledge in a time of crisis : Challenging the phantom of liberty (2014), New York, Routledge.[↩]
- Le décroissant qui voudra rester cantonné à son refus intransigeant de toute verticalité devra finir par reconnaître que la défense des ses valeurs ne pourra que se noyer dans l’océan indifférencié de l’horizontalisme. La tentation de les sauver en se réfugiant dans un « oasis », ou un « archipel » ne sera qu’une tentative désespérée et impolitique.[↩]
- Onofrio Romano ne fait pas explicitement le rapprochement mais comment ne pas le faire à sa place : ce tournant néolibéral qui va être celui de la relance du paradigme croissanciste et en même temps l’entrée de la décroissance dans l’impasse d’une économie de la rareté : encore aujourd’hui, tout décroissant ne manque pas de se référer aux rapport sur Les limites de la croissance et aux travaux de N. Georgescu Roegen : travaux qui n’étaient pas faux mais qui n’étaient vrais qu’en s’enfermant dans les limites de l’économie particulière.[↩]
- Cette explication par une politique de précarisation contrainte marche parfaitement pour la récente réforme française des retraites. Avant de vouloir équilibrer un système, il s’est agi en priorité d’instaurer un système pour déséquilibrer les individus.[↩]
- Sur le site de la MCD : https://ladecroissance.xyz/2021/06/26/dossier-sur-le-revenu-inconditionnel/.[↩]
- Michel Lepesant, https://decroissances.ouvaton.org/2021/03/12/eloge-indivision-sociale/.[↩]
- Michel Lepesant, « Portrait du décroissant en militant-chercheur », Mondes en décroissance [En ligne], 1 | 2023. URL : http://revues-msh.uca.fr/revue-opcd/index.php?id=218[↩]