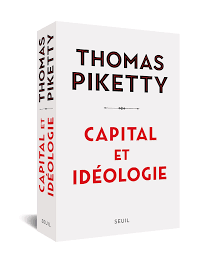Malthus, Ricardo, Marx, Piketty 2013 constituent une longue lignée d’économistes qui, malgré toutes leurs différences, ont en commun de croire que le capitalisme recèlerait une contradiction interne qui saperait son existence :
- Pour Malthus (1766-1834), jamais la croissance (arithmétique) de la production ne pourra suivre la croissance (géométrique) de la population.
- Pour Ricardo (1772-1823), la croissance économique et démographique conduit inexorablement à une hausse du prix de la terre en faveur des rentiers, ce qui réduit d’autant la part du reste de la population.
- Pour Marx (1818-1883), la tendance « naturelle » du capital à s’accumuler aboutit soit à une baisse tendancielle du taux de rendement du capital (ce qui sape le moteur de l’accumulation), soit la part du capital s’accroît sans frein au détriment de la part du travail au point de ne plus pouvoir garantir même le renouvellement de la force de travail.
- Pour Piketty (1971- ), depuis les années 1980, nous assistons non seulement à une explosion des très hauts revenus du travail (sécession des élites managériales) mais le taux de rendement du capital (r) s’établit fortement et durablement au-delà du taux de croissance (g) : r > g (c’est « la contradiction centrale du capitalisme », Le capital au XXIe siècle (2013), page 942).
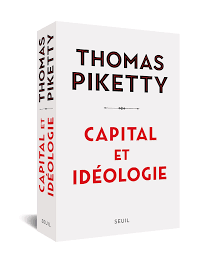 Thomas Piketty, dans Capital et idéologie (2019) rompt avec cette lignée « matérialiste » et propose au contraire une critique idéologique du capitalisme : « Les idées et les idéologies comptent dans l’histoire » (page 20). L’histoire qu’il va dresser dans ce volumineux ouvrage (1198 pages) est autant celle des inégalités que celle des idéologies produites pour justifier ces inégalités. « Chaque société humaine doit justifier ses inégalités : il faut leur trouver des raisons, faute de quoi c’est l’ensemble de l’édifice politique et social qui menace de s’effondrer » (page 13, c’est la première phrase de l’Introduction) .
Thomas Piketty, dans Capital et idéologie (2019) rompt avec cette lignée « matérialiste » et propose au contraire une critique idéologique du capitalisme : « Les idées et les idéologies comptent dans l’histoire » (page 20). L’histoire qu’il va dresser dans ce volumineux ouvrage (1198 pages) est autant celle des inégalités que celle des idéologies produites pour justifier ces inégalités. « Chaque société humaine doit justifier ses inégalités : il faut leur trouver des raisons, faute de quoi c’est l’ensemble de l’édifice politique et social qui menace de s’effondrer » (page 13, c’est la première phrase de l’Introduction) .
Nous n’allons pas proposer une recension exhaustive de ce livre d’histoire (surtout dans les 3 premières des 4 parties) qui est passionnant, mais nous nous contenterons d’essayer d’en extraire tout ce qui serait profitable pour une philosophie politique telle que la décroissance, à partir du moment où celle-ci ne veut pas/plus se contenter de quelques slogans paresseux et autres revendications d’autant plus péremptoires qu’elles sont coupées de toute réalité vécue et réfléchie.
→ Pour une lecture pleine de mauvaise foi, la critique parue sur Slate.fr permet a contrario de faire ressortir les points forts du livre.
→ Thomas Piketty met à notre disposition une présentation-diapo de son propre livre : version courte et version longue.
Une histoire des régimes inégalitaires : « une vaste remise en perspective »
L’objectif idéologique de Thomas Piketty est la défense d’un socialisme participatif et d’un social-fédéralisme fondés sur un dépassement de la propriété privée et une défense radicale de l’impôt (fortement) progressif comme outil principal de redistribution. Son argumentation est principalement historique : elle consiste à retracer une histoire pour en tirer quelques leçons. Cette histoire est celle des régimes inégalitaires 1. « De cette analyse historique émerge une conclusion importante : c’est le combat pour l’égalité et l’éducation qui a permis le développement économique et le progrès humain, et non pas la sacralisation de la propriété, de la stabilité et de l’inégalité » (page 15). Mais alors par quelles étapes en sommes-nous, aujourd’hui, arrivés à un régime hyperinégalitaire, entrepreneurial, néopropriétariste, méritocratique ?
- Le passage de sociétés ternaires (les 3 ordres du féodalisme en Occident médiéval + « enchevêtrement » des droits et pouvoirs) à des sociétés de propriétaires repose à la fois sur une promesse d’émancipation individuelle (en théorie le droit de propriété est ouvert à tous) et sur une sacralisation de la propriété privée (Thomas Piketty ne le cite pas mais John Locke est celui qui conceptualise l’articulation entre liberté de conscience, droit de propriété privée et reconnaissance sociale par la valeur ajoutée par le travail au travers, à chaque fois, d’une même question : comment justifier la « continuité », de la conscience comme de la propriété ?).
- » Ce sont les doctrines chrétiennes qui ont élaboré <le droit de propriété moderne> au fil des siècles pour assurer la pérennité de l’Église en tant qu’organisation à la fois religieuse et possédante » (page 125) : à cause du célibat des prêtres, la continuité de la propriété ne pouvait reposer sur le droit de succession, c’est donc la propriété en tant que telle qui devait être sacralisée. La Glorius Revolution de 1688, comme la révolution française de 1789 en seront les prolongations.
- Dans les sociétés de propriétaires, le droit de propriété est garanti par le pouvoir régalien de l’État : dont les recettes fiscales représentent 6-8 % du revenu national (à la fin du 18ème siècle) alors qu’elles n’étaient que de 1-2 % au début du 16ème siècle (page 435). Ces recettes fiscales financent les forces policières et surtout militaires.
- A partir du 19ème siècle, le capitalisme peut ainsi se définir comme le « propriétarisme à l’âge de la grande industrie et des investissements financiers internationaux » (page 189).
- Dans la partie II, Thomas Piketty met en perspective le passage des sociétés ternaires à des sociétés de propriétaires avec le passage des sociétés esclavagistes à des sociétés coloniales (de 1500 à 1960). Non seulement les puissances européennes se sont taillés des empires coloniaux mais, en Inde en particulier, ils ont favorisé et rigidifié des conceptions inégalitaires favorables à leur idéologie propriétariste.
- Les abolitions de l’esclavage par les mécanismes de compensations et d’indemnisations des propriétaires d’esclaves participeront au 19ème siècle à la sacralisation de la propriété privée.
→ Thomas Piketty ne manque pas de rappeler – données chiffrées à l’appui – que les régimes propriétaristes aboutiront juste avant 1914 à l’explosion des inégalités, à l’hyperconcentration de la propriété : « La quasi-totalité de la propriété était concentrée au sein du décile supérieur, et la plus grande part au sein du centile supérieur, alors que l’immense majorité de la population ne possédait presque rien » (page 166). Pour donner un ordre d’idée chiffré : le décile supérieur possédait entre 80 % et 90 % du patrimoine total et 1% des décès des plus riches avoisine les deux tiers de la valeur des transmissions en 1910.
La troisième partie va se consacrer à l’histoire des inégalités aux XXème et XXIème siècles, trois grandes époques se dégagent :
- 1914- 1945 : la crise des sociétés de propriétaires. Montée en puissance de l’État fiscal avec : des recettes fiscales qui vont monter jusqu’à 30-50 % du revenu national (page 435) ; des impôts progressifs avec des taux de prélèvement inimaginables aujourd’hui de 81 % en moyenne pour les revenus et de 75 % pour les successions aux USA (sur la période 1932-1980) (page 524)
- 1950 ~ 1980 : les sociétés sociales-démocrates. Renforcement de l’État fiscal : des prélèvements exceptionnels pour réduire les dettes (page 519), plutôt que l’hyperinflation de l’entre-deux guerres ; non seulement cette montée en puissance n’a pas empêché la reconstruction mais elle a assuré la réduction des inégalités ainsi que le financement de l’État social (éducation, santé, retraite, assurance-chômage) (page 540).
- 1980 → : l’hypercapitalisme des sociétés néo-propriétaristes. Retour des inégalités, « explosion aux USA des plus hautes rémunérations des cadres et des dirigeants d’entreprise » (page 496), recul du consentement fiscal, faible croissance. « Le retour d’une très forte concentration de la propriété doublée d’une grande opacité financière, est l’une des caractéristiques majeures du régime inégalitaire néopropriétariste mondial en ce début du XXIème siècle » (page 800). « Si l’on compare le cas de l’Inde, des États-Unis, de la Russie, de la Chine et de l’Europe, on constate ainsi que la part du décile supérieur se situait aux alentours de 25 %-35 % du revenu total de chacune de ces cinq régions en 1980, et qu’elle se situe autour de 35 %-55 % en 2018 » (page 36), et cela au détriment des plus pauvres dont la part passe de 20 %-25 % à 15 %-20 % (moins de 10 % aux États-Unis.
Toutes ces données historiques fournissent des arguments pour s’opposer à la réécriture néolibérale de l’histoire : en dressant un tableau fictif de l’État social qui serait dispendieux, on sait comment les néolibéraux imposent une baisse des recettes fiscales, d’où une détérioration des services publics sur laquelle ils s’appuient ensuite pour vanter leur remplacement par des dispositifs privés. On le voit aujourd’hui dans l’éducation, la santé, le système de retraite… « Les pays riches sont riches ; ce sont leurs gouvernements qui ont choisi de devenir pauvres, ce qui est très différent. Rappelons également que ce bien les propriétaires des pays riches qui détiennent en moyenne les dettes de leur pays » (page 715), en particulier dans les paradis fiscaux (note 1 page 715).
Bien sûr beaucoup de réticences
Mais l’ouvrage n’est pas seulement un livre d’histoire des données, il est aussi un livre d’histoire des idéologies. et c’est là que – en tant que décroissants – nous pouvons exprimer quelques réticences :
- Son argument principal en faveur de forts taux de prélèvements fiscaux, c’est qu’historiquement ils n’ont empêché nulle croissance, bien au contraire même quand on compare la période 1950-1980 avec la période suivante. La dispute avec les néolibéraux n’est donc pas « pour ou contre la croissance ? » mais, « pour favoriser la croissance, pour ou contre la fiscalité ? ». Il a raison de signaler (page 541) qu’aujourd’hui il est faux d’affirmer que la baisse des impôts permettrait de relancer la croissance. Mais il a tort d’oublier a/ que si pendant la période sociale-démocrate il y a eu croissance, c’est d’abord parce qu’elle a été nourrie par les reconstructions d’après-guerre et b/ que dans la période suivante, il y a peut-être moins de croissance – c’est un fait – mais néanmoins c’est toujours au nom de l’idée de la croissance pour la croissance que l’idéologie néolibérale justifie sa démolition de l’État fiscal et social.
- La même réticence vaut pour sa critique des inégalités de patrimoine : « On sait maintenant que la part du centile supérieur dans la propriété totale peut chuter de 70 % à 20 % sans affaiblir la croissance (bien au contraire, comme le montre l’expérience des pays ouest-européens au XXème siècle » (page 689).
→Écrivons tout de suite que si l’histoire nous apprend que la croissance n’a été défavorisée ni par une forte fiscalité progressive ni par une réduction forte des inégalités alors notre défense de telles mesures devra passer par une critique non économique de la croissance (économique). Pour le dire plus directement, si la décroissance veut éviter le modèle social-démocrate (fiscalité progressive + faible niveau d’inégalités mais forte croissance) alors ce ne devra pas être au nom de l’efficacité économique (la productivité, la création d’emplois, la compétitivité) mais aux nom de principes d’entretien de la vie sociale et de responsabilité écologique pour obtenir : décroissance + fiscalité très fortement progressive (confiscatoire) = réduction drastique des inégalités.
- Tout occupé à sa juste critique des inégalités, Thomas Piketty en vient à oublier de répéter sa distinction entre faits et idées. Car alors que dans son introduction au Capital au XXIème siècle, Thomas Piketty rappelait que le principal oubli des critiques classiques du capitalisme (Malthus, Ricardo, Marx) était de ne pas avoir envisagé le potentiel de croissance qui sera fourni par les « progrès » technologiques, on peut lui adresser ce même reproche : l’histoire du capitalisme, à chacune de ses périodes, n’est jamais corrélé avec la moindre révolution technique. Pour le dire autrement, le capitalisme n’est jamais envisagé comme un monde qui fournit d’abord des modes de vie de plus en plus emprisonnés dans des modes d’emploi.
- Faut-il s’étonner de ne trouver chez Thomas Piketty aucune considération autocritique sur la croissance et son moteur technologique quand on voit le peu de lignes consacrées à la question écologique ? Mais il faut être juste, par rapport à son livre précédent, la prise de conscience écologique de Thomas Piketty semble avancer : l’anthropocène y est même citée 1 fois (page 1178) ! Et on peut se réjouir par 2 fois de lire : « La notion même de “productivité”… n’a aucun sens si cela pour conséquence de rendre la planète invivable » (page 600). Il évoque même « des gisements pétroliers qui feraient mieux de rester dans le sol pour éviter le réchauffement climatique » (page 762) 2. Il y a aussi une proposition de fiscalité écologique quand il défend « une véritable taxation progressive des émissions carbone au niveau des consommateurs individuels » : les 5 premières tonnes seraient exonérées puis les tonnes suivantes seraient de plus en plus fortement taxées, jusqu’à une « émission interdite sous peine de sanction dissuasive (par exemple au travers d’une taxation confiscatoire du revenu ou du patrimoine) »(page 1158). Bon, il y a encore de quoi faire !
- Thomas Piketty propose un socialisme participatif et fédératif, pourquoi pas. Mais il ne conçoit ce fédéralisme que dans un cadre « européen », pourquoi pas. Mais de quelle « Europe » s’agit-il ?
Mais surtout des questions et des défis
Aucune de ces réticences idéologiques ne peut fournir motif pour se dispenser de lire ce livre d’histoire des régimes inégalitaires. D’autant qu’au fur et à mesure des récits (et des voyages), Thomas Piketty ne perd jamais de vue que cette histoire est aussi une histoire des systèmes de justification des inégalités et que c’est précisément cette histoire qui doit nourrir les discussions politiques d’aujourd’hui (page 1198 – c’est la dernière page) :
« Le journaliste et le citoyen s’inclinent trop souvent devant l’expertise de l’économiste, pourtant fort limitée, et se refusent à avoir une opinion sur le salaire et le profit, l’impôt et la dette, le commerce et le capital… Ce livre a dans le fond un unique objet : contribuer à la réappropriation citoyenne du savoir économique et historique. »
Il y a des comptes rendus qui peuvent nous dispenser de lire l’ouvrage. Impossible cette fois-ci. Difficile donc de « résumer ». Alors je me contenterai de relever 3 axes de réflexions qui devraient être traités comme autant de défis idéologiques par les décroissants – surtout s’ils ne veulent pas rester prisonniers de leurs colères et de leurs peurs, en croyant les guérir par un surcroît de rêves.
- Thomas Piketty défend un « socialisme participatif ». Reconnaissons que ce socialisme repose sur une « ontologie solidariste » de la société que les décroissants – en tant que « socialistes » – devraient tous partager (plutôt que de risquer de basculer dans une ontologie individualiste de la société). Par 2 fois (dans des notes pages 655 et 1116) est ainsi évoqué le nom de Léon Bourgeois, qui mériterait tellement d’être reconnu comme un précurseur de la décroissance (à condition de voir dans la décroissance plus une doctrine sociale qu’une variante radicale ou sociale ou libertaire de l’écologie) : « Car au fond toutes les richesses sont sociales » (page 655 et note 1). Comment le justifier ? « Compte tenu des très grandes difficultés objectives liées à la mesure de la contribution individuelle » (page 621) à moins « d’oublier que rien de tout cela <les job creators de Trump ou les « premiers de cordée de Macron> n’existerait sans les systèmes publics de formation et de recherche fondamentale et les appropriations privées de connaissances publiques »‘ (page 1024). Est ainsi a/ sapée l’idéologie méritocratique en faveur des « entrepreneurs créateurs de richesses » mais b/ est aussi fondée la légitimité d’un retour de cette richesse produite socialement à toute la société plutôt que de – comme aujourd’hui – laisser une infime minorité se l’approprier, se la privatiser (dans ce cas, ce « retour à la vie sociale » est un « revenu » et nul ne devant en être exclu, il devrait être « inconditionnel »). C’est (encore une fois) dans une note consacrée à la question des frontières et à la possibilité d’une exit tax que Thomas Piketty donne le fondement de cette conception solidariste de la société : « Il n’existe aucun droit naturel à s’enrichir en profitant du système collectif, légal, éducatif, etc., d’un pays donné puis à en extraire la richesse sans en reverser la moindre part » (note 2 page 1144).
- Thomas Piketty défend l’impôt et surtout sa progressivité au point de proposer « d’inscrire dans les constitutions un principe minimal de justice fiscale fondé sur la notion de non-régressivité » (page 1150). La défense de l’impôt par Thomas Piketty est solidement construite : a/ quand à son fondement : « L’instrument principal permettant à une collectivité de mobiliser des ressources en vue d’un projet politique commun reste et demeure l’impôt, collectivement débattu et établi, prélevé en fonction des richesses et de la capacité contributive de chacun, en toute transparence » (page 820) ; b/ quand à son objectif : « Outre le système légal et le droit du travail et des entreprises, il faut souligner que le système fiscal peut également avoir un impact déterminant sur les inégalités primaires » (page 620) ; c/ quant à ses modalités : « L’impôt juste doit reposer sur un équilibre entre trois formes légitimes et complémentaires d’impôt progressif : l’impôt progressif sur le revenu, l’impôt progressif sur les successions et l’impôt annuel sur la propriété » (page 638). « L’expérience historique indique cependant que ces deux <premiers> impôts ne sont pas suffisants et qu’ils doivent être complétés par un impôt progressif annuel sur la propriété, qui doit être considéré comme l’outil central permettant d’assurer une véritable circulation du capital » (page 1123) ; d/ quant à ses taux potentiellement drastiques : pour l’impôt sur la propriété, « des taux de 10 % ou 20 % peuvent avoir le même effet <que des taux de 60 % ou 90 %> en quelques années » (page 1136) ; e/ quant à la part prélevée sur le revenu national : 50 % réparti entre impôt sur le revenu (45 %) et impôts sur succession et propriété (5 %) (page 1129). Évidemment pas de fiscalité sans un État fiscal, ou du moins sans une institution, une collectivité assurant la collecte des recettes et la répartition des dépenses, voire même pour Piketty un État-employeur : « A partir du moment où l’État assure lui-même la production d’un certain nombre de biens et services (notamment dans l’éducation et la santé), il ne serait pas anormal qu’il détienne une part du capital productif qui soit en rapport avec sa part dans l’emploi total (mettons autour de 20 %) » (page 717). Qu’en mots choisis, Thomas Piketty en vient à défendre une propriété collective de certains moyens de production ! Ce qui vaudrait pour un « État » vaudrait en réalité pour toute forme de collectif/mutuelle politique organisant un projet de vie sociale…
- Le socialisme de Piketty ne propose pas une abolition de la propriété privée mais son « véritable dépassement » (page 339). La question de la légitimité de la propriété privée doit être débattue et non pas rejetée d’un revers de main anarchiste : osons nous demander quelle pourrait bien être la forme d’une société moderne (reconnaissant donc le droit personnel de chacun à une part d’autonomie – ce qui est la promesse de la modernité) dans laquelle il n’y aurait aucune propriété privée. Thomas Piketty n’en est pas là car, pour lui, « le droit de propriété privé n’est légitime que dans la mesure où il contribue au bien-être général de la collectivité » (page 580) : c’est conforme à l’esprit de son « socialisme participatif ». Quant aux biens professionnels, il poursuit : « On peut dire qu’il existe trois façons de dépasser le système fondé sur la propriété privée des entreprises et la toute-puisance des actionnaires. Il s’agit d’une part de la propriété publique : l’État central, une collectivité locale… Il s’agit d’autre part de la propriété sociale : les salariés participent à la direction des entreprises et partagent le pouvoir avec les actionnaires privés… éventuellement en les en évinçant complétement. Il s’agit enfin de ce que je propose d’appeler la “propriété temporaire” : les propriétaires privés les plus fortunés doivent rendre chaque année à la collectivité une partie de ce qu’ils possèdent » (page 576).
Toute ses propositions pourraient être prises avec considération par des décroissants qui se poseraient en pleine maturité idéologique la question du trajet pour sortir du monde de la croissance et passer dans un monde post-décroissance. D’autant qu’ils auraient aussi à se confronter avec deux autres propositions envisagées par Thomas Piketty : la « dotation universelle en capital » (page 1129) et « une version relativement ambitieuse du revenu de base » (page 1153).
→ Le principal intérêt politique de ce livre d’histoire par delà ses propres propositions n’est-il pas de mettre les décroissants face à une liste de questions politiques pour lesquelles il va nous falloir produire un considérable effort de réflexion idéologique :
- Comment reconsidérer l’État ou du moins une forme socialement acceptable de « collectivité/institution ayant un projet politique commun » qui permettra à la fois de dépasser une pure horizontalité des individus et de collecter quelques moyens (à définir) pour contribuer à des charges collectives (d’éducation, de santé, de transport…) ?
- Comment reconsidérer la propriété privée pour la ramener le plus possible à un droit d’usage, pour éviter toute accumulation ?
- D’une façon encore plus élargie, quel type d’institutions (frontières, subsidiarité, fédéralisme, pouvoirs régaliens, formes de la décision…) sommes-nous prêts à envisager dans une société post-décroissance ?
- Et dans une société post-décroissance y aura-t-il encore des entreprises, un marché économique, des prix, des échanges entre territoires, des dettes ?
Aujourd’hui sur toutes ces questions difficiles les décroissants ne sont-ils pas des nains idéologiques ? Nous avons des réponses générales telle un principe de double limitation (espace écologique en plancher/plafond) ; ce qui n’est pas si mal mais très insuffisant.
_____________________Les notes et références
- La notion de « régime inégalitaire » englobe celles de régime politique et de régime de propriété – page 19.[↩]
- Ne pas extraire, c’est tout de même plus responsable que de se contenter de désinvestir, comme il le proposait en 2015 dans une tribune cosignée avec Tim jackson.[↩]