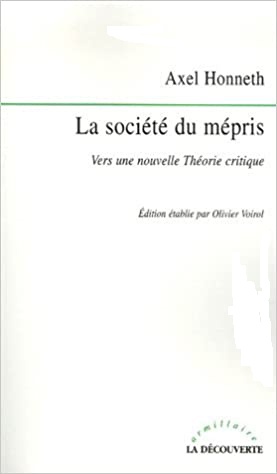A propos du livre d’Axel Honneth, La société du mépris (La Découverte, Paris, 2006). La question de la reconnaissance est une revendication morale et non matérielle. Est-ce à dire que toute revendication matérialiste doit être congédiée ? Et avec elle, faut-il aussi « ringardiser » toute lutte des classes ? Quels rapports entre lutte pour la reconnaissance et lutte des classes ?
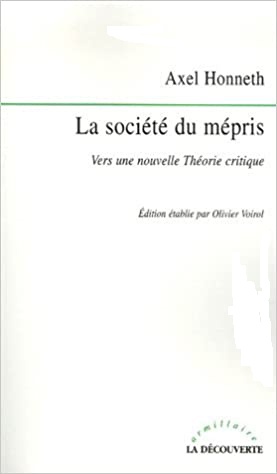 Ce recueil de 11 textes publiés entre 1981 et 2004 est un livre de « philosophie sociale », caractérisée par « sa réflexion spécifique sur les critères de la « vie sociale réussie » et son attention systématique aux « évolutions sociales pathogènes » » (Préface d’Olivier Voirol, p.24).
Ce recueil de 11 textes publiés entre 1981 et 2004 est un livre de « philosophie sociale », caractérisée par « sa réflexion spécifique sur les critères de la « vie sociale réussie » et son attention systématique aux « évolutions sociales pathogènes » » (Préface d’Olivier Voirol, p.24).
Il prolonge ainsi le projet qu’Axel Honneth a commencé dans La lutte pour la reconnaissance, à savoir construire un argumentaire dirigé « contre la tendance à réduire toutes les questions normatives concernant l’ordre social au problème de la justice ». Autrement dit, il vient utilement rappeler que même une société juste et bien ordonnée équitablement peut être désagréable à vivre : « une société peut aussi échouer dans un sens plus global, à savoir dans sa capacité à assurer à ses membres les conditions d’une vie réussie » (Avant-propos, p.35). Une société pourtant juste peut quand même être une « société du mépris ».
Chacun voit facilement comment une telle thèse peut venir s’opposer à toute une tradition de contestation sociale. Même si dans son argumentation, Honneth prend toujours bien soin de rappeler qu’il n’y a pas opposition mais intrication ou complémentarité, il n’empêche que toute une tradition de revendications seulement « matérialistes » peut se sentir provoquée par une telle quête « morale » ou « post-matérialiste » de reconnaissance.
C’est précisément cette difficulté – le risque de cette exigence identitaire de reconnaissance, si elle est propre seulement à une certaine classe petite bourgeoise, les « bobos », serait de ne pouvoir réussir qu’en « ringardisant » les revendications traditionnelles du monde du travail – qui peut permettre de relier deux des 11 articles du recueil : l’un est le plus ancien, il date de 1981, donc bien avant qu’Honneth dispose explicitement de sa théorie d’une lutte pour la reconnaissance et il porte sur la relation entre « conscience morale et domination de classe » ; l’autre date de 2004 et il affronte une objection sérieuse dirigée déjà contre les thèses de Honneth : « bien loin de contribuer à l’amélioration durable de l’autonomie des membres de notre société, la reconnaissance sociale semble apparemment servir à la production de représentations conformes au système » (p.245). On comprend alors le paradoxe : non seulement, la reconnaissance ne pourrait pas être une revendication sociale mais elle serait même un outil de domination du capitalisme avancé.
Chapitre 6- Conscience morale et domination de classe. De quelques difficultés dans l’analyse des potentiels normatifs d’action.
L’article semble d’abord écrit comme une histoire interne de la Théorie critique. Ses figures tutélaires, Adormo, Marcuse et Habermas, semblent faire fond sur deux constats : (a) « l’effondrement de la confiance du marxisme en la révolution » (p.203) ; (b) le capitalisme peut se maintenir « parce que les préjudices practico-moraux subis par la classe des travailleurs ont été largement compensés sur le plan matériel et détournés vers une attitude de consommation privée » (p.205).
Adorno et Marcuse en tirent la conclusion qu’une critique sociale ne peut plus être rattachée à une « moralité empiriquement opérante » (p.204) et proposent alors de compenser la désillusion révolutionnaire soit du côté de l’esthétique et de l’œuvre d’art pour Adorno, soit du côté « d’une théorie freudienne des pulsions qui enracine l’action émancipatrice dans une réserve d’élans érotiques inaccessibles à la société » pour Marcuse. Au contraire, Habermas pense découvrir dans les réformes du capitalisme tardif la « force empirique d’une conscience morale » mais il suggère que ce processus possible n’est capable de trouver un support que dans des « avant-gardes qui réclament pour tous les bénéfices normatifs de la morale universelle bourgeoise » (p.205), par exemple la jeunesse contestataire…
Honneth pense que cette analyse de Habermas néglige « systématiquement toutes les formes de critique sociale qui ne sont pas reconnues dans l’espace politique dominant » (p.206). Pour le démontrer, il essaie (I) de rappeler que l’expression des conceptions morales ne sont pas formulées de la même façon dans les classes bourgeoises et dans les classes opprimées ; (II) de montrer qu’un contrôle social permet à l’État ou aux entreprises de juguler « les tentatives des classes défavorisées pour formuler et rendre publics leurs sentiments d’injustice » (p.213) puis de les refouler ; (III) d’en déduire que l’intégration de toutes les classes sociales dans le capitalisme du XXe siècle ne pourrait être qu’une façade derrière laquelle « les anciennes confrontations de classe se reproduisent sous des formes nouvelles » (p.206).
(I) Comment expliquer « le contraste brutal entre les conceptions bourgeoises de la justice, telles qu’elles sont formulées et fondées normativement dans les cultures d’experts ou les avant-gardes politiques, et la morale sociale profondément fragmentée, variable d’une situation à l’autre, qui a cours dans les classes opprimées » (p.207) ? D’autant plus fragmentée qu’elle se constitue d’abord à partir d’expérience directe, de tradition orale ou de mémoire populaire qui filtrent ensuite les systèmes de normes (que ceux-ci soient de légitimation ou de critique de l’ordre social). Non pas à cause d’une quelconque infériorité intellectuelle des classes opprimées mais à cause de « la pression directe que le problème normatif exerce sur elles » (p.209).
Psychologiquement parce que l’implication émotionnelle des situations ne permet à aucun sujet agissant d’être en même temps le théoricien de sa pratique.
Socialement, parce que l’incitation à définir des normes d’action dans un système cohérent est très faible dans les classes défavorisées. En premier lieu parce que « les dominés ne sont soumis à aucune contrainte sociale de légitimation » (p.210). Au contraire des classes privilégiées qui doivent fournir une justification de leur privilèges du point de vue de l’ensemble de la société. En second lieu, parce que les classes socio-économiquement défavorisées le sont aussi culturellement : « les processus institutionnels et scolaires de la reproduction les empêchent de mettre en perspective et de verbaliser leurs normes d’action » (p.211).
Par conséquent, celui qui mesurerait le potentiel normatif d’un groupe social seulement à l’aune d’une représentation collective et explicite de justice ne manquerait pas de passer à côté de la « moralité implicite » (p.211) des classes défavorisées.
(II) D’autant plus que les institutions de la domination disposent de 2 moyens pour contrôler l’expression du sentiment d’injustice : la « déverbalisation » et l’individualisation.
Pour priver de langage les dominés, le contrôle social passe par trois interdits : « tabou de l’objet, rituel de la circonstance, droit privilégié ou exclusif de celui qui parle ». Par ces techniques, les institutions légitimes réussissent à refouler « les traditions culturelles et les processus d’apprentissage politique développés au sein des mouvements de résistance sociaux » (p.214), interdisant par là la transmission d’un monde de symboles, de mémoires et de traditions qui assurait la continuité entre les générations et exprimait l’injustice sociale.
« La panoplie des stratégies d’individualisation est extrêmement fournie : elle va de la valorisation sociopolitique des prises de risque individuelles, à la destruction administrativement programmée des lieux de voisinage, en passant par la mise en concurrence de différents secteurs au sein de la même entreprise pour améliorer la compétitivité » (p.215). De tels processus individualisent les conditions de vie, rendent plus difficile leur « identification communicationnelle » et du même coup contrôlent les sentiments d’injustice sociale.
(III) Ainsi donc, Honneth vient de se donner les moyens conceptuels pour remettre en question la thèse de la fin de la lutte des classes. Cette thèse en effet repose sur deux oublis : non seulement les conditions de l’expression de l’injustice par les classes dominés ne sont pas les mêmes que celles des classes dominantes (I) mais elle reste soumise à un « faisceau de mécanismes de contrôle » (II). Autrement dit, il ne faut pas en rester aux revendications de justice explicites pour juger en quoi les idées des défavorisés ne sont pas celles de la classe dominante.
Libérés de ces deux « oublis », Honneth peut affirmer d’une part que ce n’est pas parce l’idéologie de légitimation de « la justice distributive accordée au rendement » est pragmatiquement acceptée et tolérée qu’elle ne suscite pas en même temps un scepticisme moral et d’autre part qu’il serait réducteur de ramener les chances inégalement réparties entre les classes sociales à « la seule dimension des besoins vitaux mesurés en biens quantitatifs » (p.219).
« Il apparaît qu’une théorie des classes ajustée à la société capitaliste ne peut pas se borner à l’inégale répartition des biens matériels, mais doit aussi prendre en compte la répartition asymétrique des chances sur le plan culturel et psychique » (p.220).
C’est là que le concept d’une « lutte pour la reconnaissance » permettra à Honneth de montrer que dans le capitalisme avancé, « les luttes largement individualisées pour la reconnaissance sociale et les conflits du travail qui se déroulent tous les jours à l’insu du public, témoignent d’une condamnation morale de l’ordre social existant » (p.221).
Chapitre 8- La reconnaissance comme idéologie.
Cet article essaie de sortir d’une objection adressée à la théorie de la reconnaissance, objection qui consiste à faire peser le soupçon de l’idéologie : la reconnaissance ne serait-elle pas qu’une mystification idéologique du capitalisme recourant au sentiment d’estime de soi pour faire passer sans contrainte domination et assujettissement ? Pour échapper à un tel soupçon, Honneth est obligé de clarifier sa théorie :
« la reconnaissance n’est pas une idéologie parce qu’elle constitue la condition intersubjective pour pouvoir réaliser de manière autonome des objectifs personnels propres. Alors évidemment, pour celui qui nie – tel Althusser – toute possibilité d’une telle autonomie, la reconnaissance est un concept vide. Au contraire pour Honneth, il renvoie à ce qu’il appelle un « réalisme moral modéré » : sans croire qu’il existe un ensemble transcendant de valeurs morales, il n’est pas sociologiquement erroné de constater que le monde social est vécu comme une « « seconde nature » dans laquelle les sujets sont socialisés en apprenant progressivement à faire l’expérience des qualités des autres personnes » (p.257).
- Le caractère moral de la reconnaissance consiste alors en une « limitation de l’égocentrisme » et elle trouve à se concrétiser à partir de valeurs dignes d’être reconnues chez tous les êtres humains : amour, respect juridique et estime sociale.
- Comment distinguer dans ces conditions entre formes justifiées et formes injustifiées de la reconnaissance sociale ? Dans un premier cas, dès qu’il y a résistance des sujets concernés. Et quand il n’y a pas de protestation explicitement formulée ? Honneth propose alors de remarquer qu’une reconnaissance ne peut être « crédible » qui si à la composante évaluative s’ajoute une composante « matérielle » : sans réalisation matérielle, une reconnaissance sociale seulement symbolique est bien un idéologie de la domination.
C’est ainsi que nous pouvons constater que pour Honneth une revendication non–matérielle, morale, de reconnaissance ne ringardise aucune revendication matérielle.
Pas de méprise donc sur ce « mépris » : la lutte pour la reconnaissance n’est pas un complot du capitalisme avancé pour rejeter aux oubliettes de l’histoire la lutte des classes. Pour autant, plus question de ne pas tenir compte des capacités idéologiques et symboliques de ce capitalisme avancé pour en faire la critique.